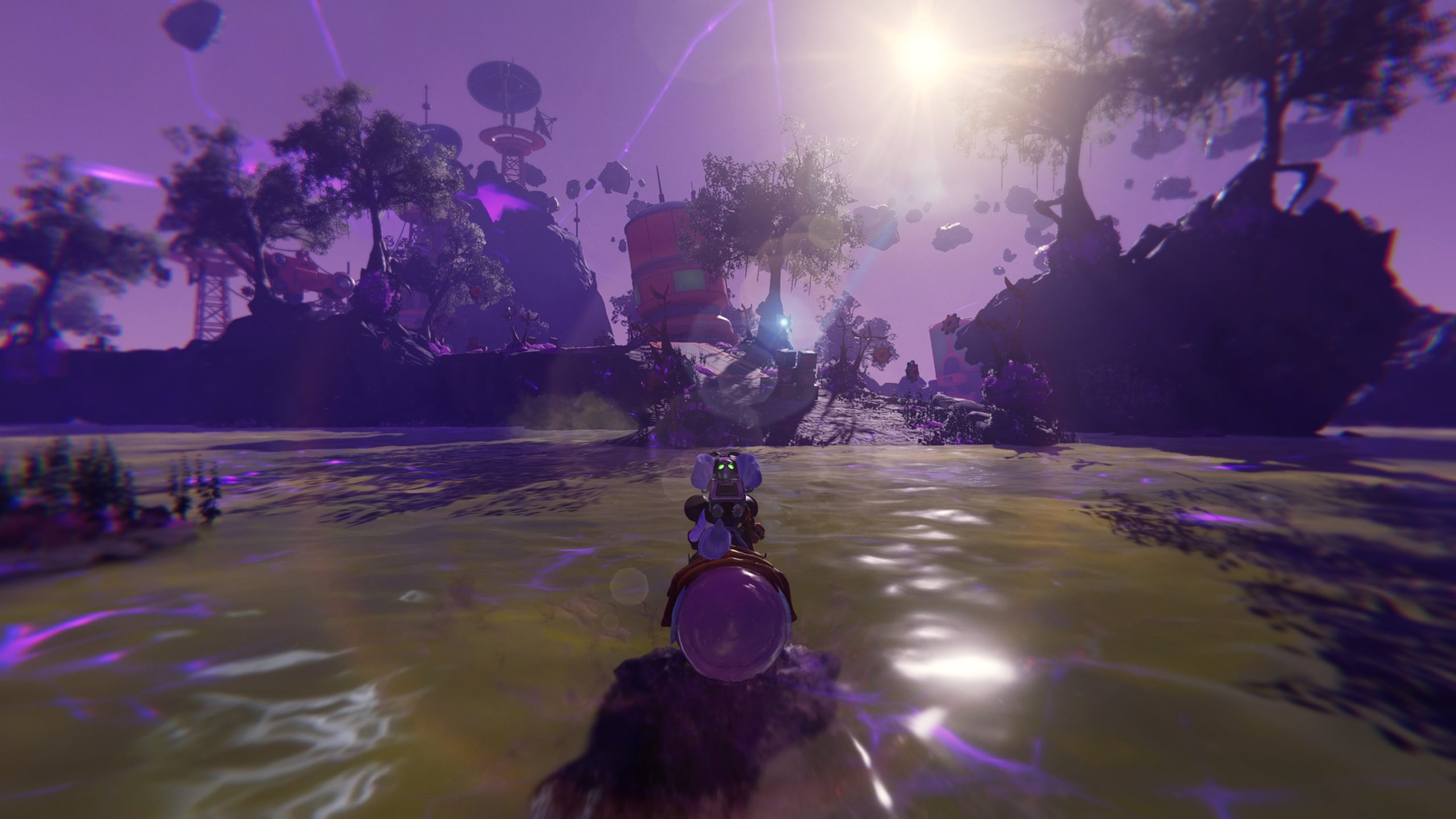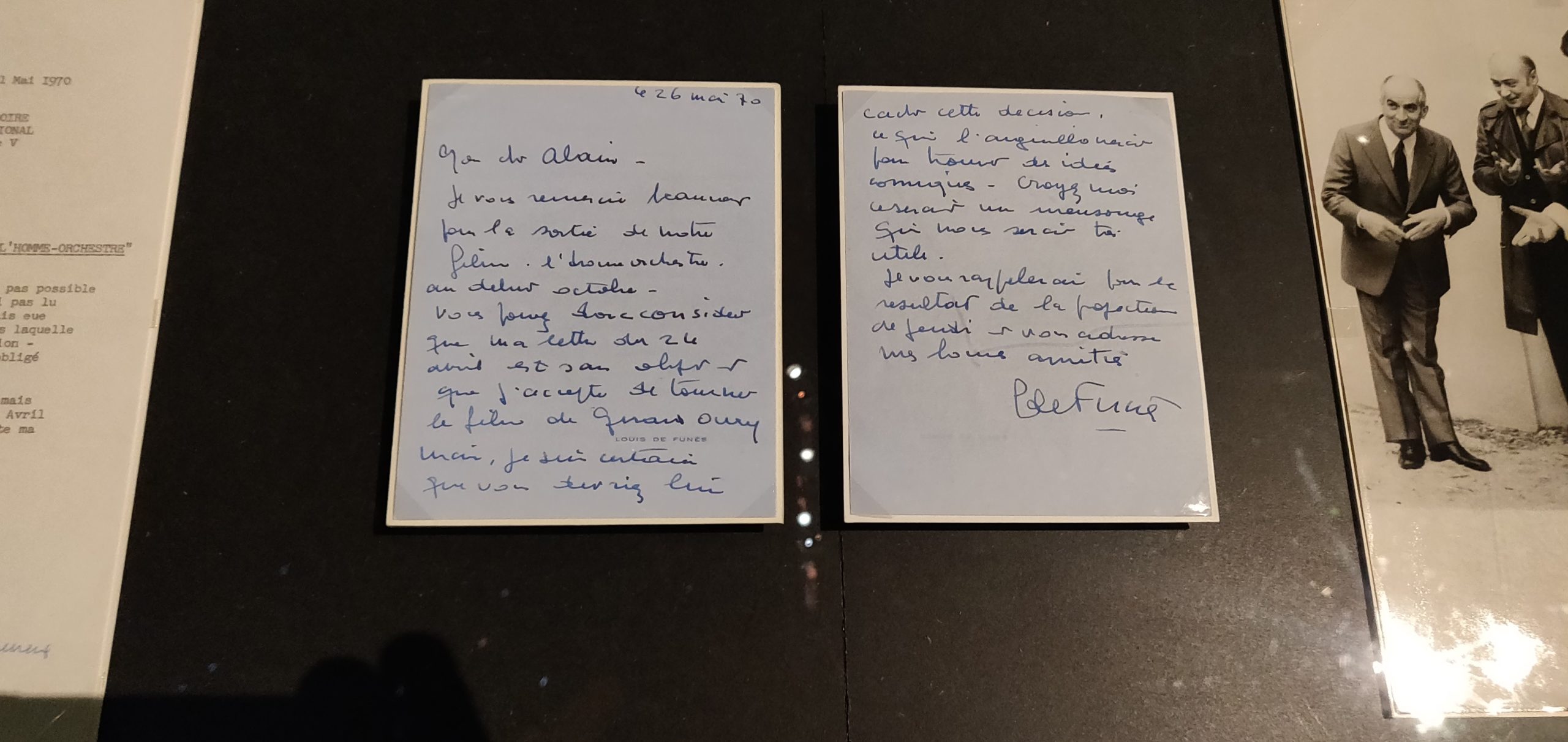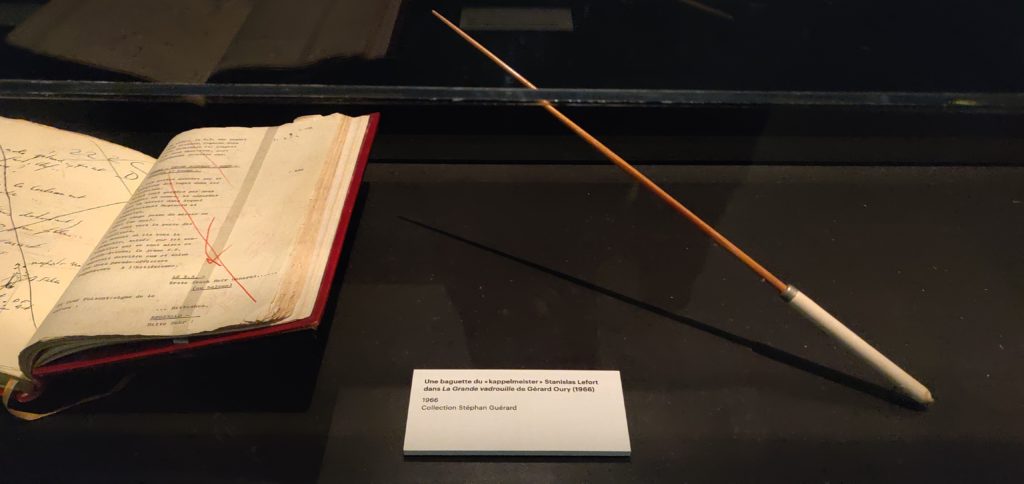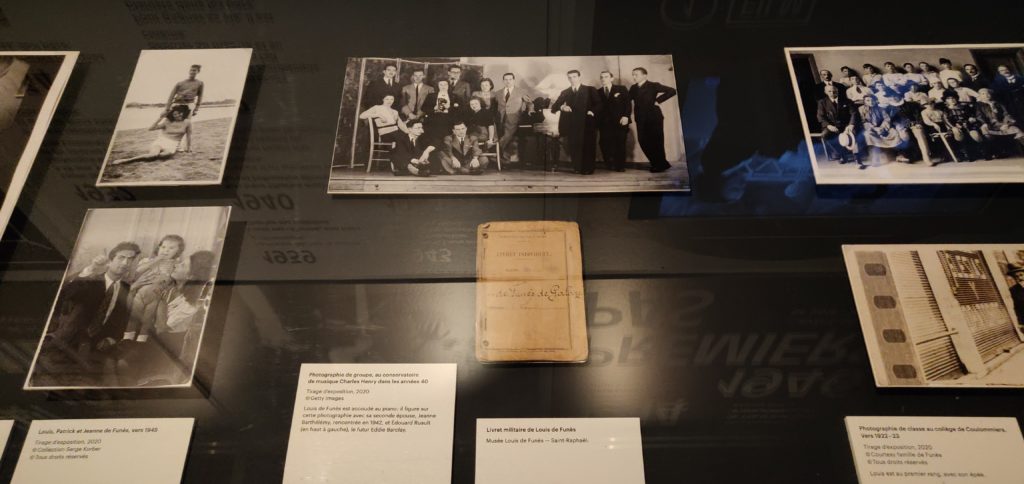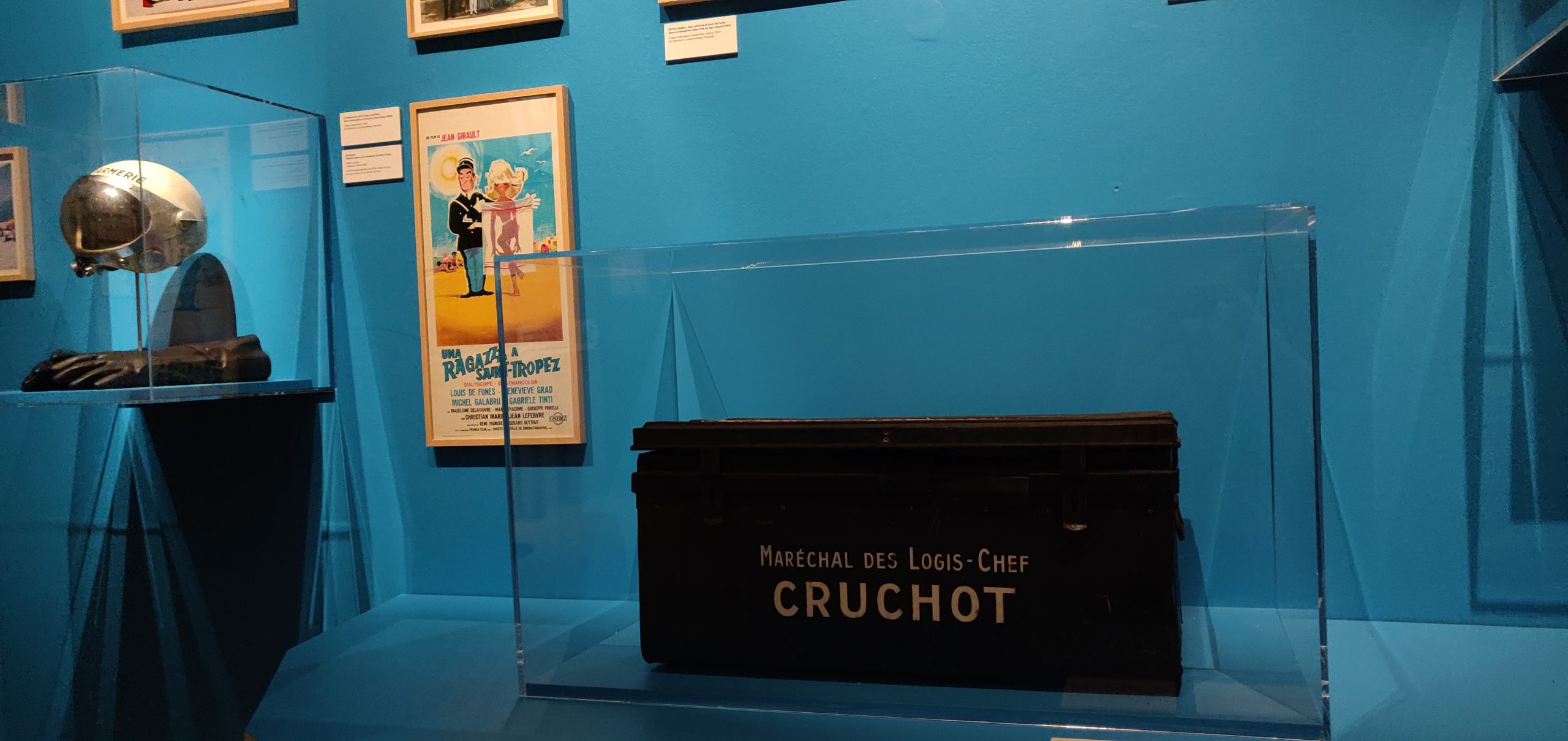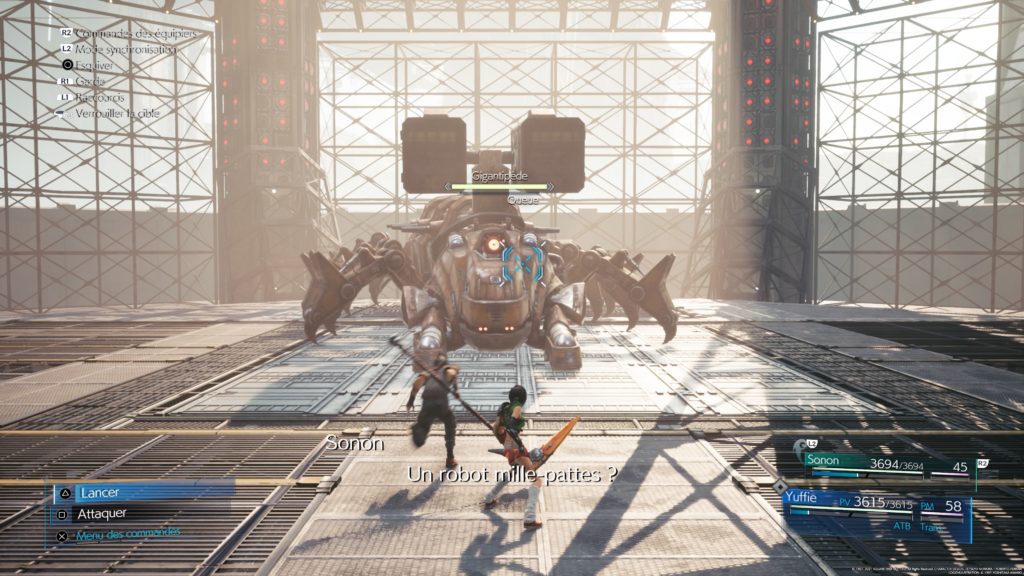Bien moins citée que Batman : The Animated Series quand il s’agit de parler des séries à la gloire des héros de DC, Superman : The Animated Series (aka Superman : L’Ange de Métropolis en France) n’en reste pas moins un show d’exception, plus héroïque et porté sur l’action que son illustre aîné, et entièrement dédiée à l’icône américaine trouvant ici sa meilleure adaptation à travers trois saisons aussi complémentaires que généreuses.
Diffusée en septembre 1996, soit quatre ans après Batman : The Animated Series, Superman : The Animated Series se termine après 54 épisodes. On ne sera pas étonnés de retrouver à la barre des anciens de Batman : TAS comme Bruce Timm, Paul Dini ou bien encore la compositrice Shirley Walker. Troquant la sombre Gotham et l’ambiance très film noir de Batman : TAS pour une Metropolis lumineuse et une atmosphère soutenue par son action frénétique, Superman : The Animated Series profite d’une intéressante courbe de progression au fil de ses saisons.
Ainsi, la première d’entre-elles composée de 13 épisodes opte pour le concept de «freak of the week» en intégrant régulièrement un vilain diffèrent. Néanmoins, dans son triptyque de départ, elle prend le temps de revenir sur les origines de Superman et lors des épisodes 9 & 10 (Le Motard du Cosmos), elle confronte l’Homme d’acier au chasseur de primes intergalactique Lobo avant de les associer contre le Préservateur, être collectionnant les espèces rares de l’univers. Cet épisode fonctionne à merveille, notamment grâce à la personnalité des deux personnages, à l’opposé l’une de l’autre. Pour l’anecdote, alors que le doubleur américain de Lobo, Brad Garret, opte pour une voix relativement sobre, le doubleur français, Pascal Renwick (voix de Laurence Fishburne), usera d’un timbre plus grave afin de donner à Lobo une côté plus roublard et finalement raccord avec son visage. Notons à ce sujet que le doublage français dans son ensemble est de grande qualité grâce aux prestations de Emmanuel Jacomy (Superman), Véronique Augereau (Loïs Lane) ou bien encore Alain Dorval (Lex Luthor). La version française contribuera ainsi, à l’instar de celle de Batman : TAS, à l’aura de qualité de la série.
La deuxième saison de 28 épisodes, délaissera un peu l’aspect «1 épisode / 1 ennemi» en proposant des scénarios plus élaborés s’étalant parfois sur deux voire trois épisodes à l’instar de Nec Plus Ultra qui fait intervenir Batman. Ce premier crossover s’avère savoureux à plus d’un titre en réunissant les deux justiciers pour affronter Luthor et Le Joker. L’écriture est excellente et trouve toujours le ton juste entre humour et action ou bien encore grâce au triangle amoureux, entre Loïs, Bruce et Superman, qui ajoute une histoire supplémentaire à l’intrigue. L’épisode évite qui plus est l’affrontement entre Batman et Superman en préférant jouer sur la révélation de l’identité secrète des deux héros afin de bien dissocier « leurs méthodes de travail ».
Ce triple épisode d’une heure compte parmi les meilleurs de toute la série et profite qui plus est de l’animation impeccable du studio Tokyo Movie Shinsha qui s’était déjà illustré dans Batman : TAS ou bien encore le très bon Batman La Relève : Le Retour du Joker.
Cette saison se montre également beaucoup plus variée dans ses péripéties ou même son ton en faisant intervenir une combattante de caractère (Maxima la Reine Guerrière), celui d’Electra pour la toute première fois dans le DC Animated Universe ou bien encore Mxyzptlk dans l’épisode du même nom. Ce dernier se montre également exquis en terme d’écriture et pour une fois essentiellement basé sur l’humour. Superman joue en effet de son intelligence afin de se débarrasser tous les trois mois de Monsieur Mxyzptlk, inénarrable farceur dans la grande tradition des Tex Avery, vivant dans la Cinquième dimension.
Citons également le double épisode Centrale Nucléaire faisant intervenir Dark Seid et le dernier épisode, lui aussi en deux parties (La Petite Fille Perdue) et mettant en vedette Kara, une jeune Kryptonienne que Clark va prendre sous son aile et qui deviendra par la suite Supergirl.
La troisième saison de 13 épisodes se recentrera sur des scripts moins denses, sans pour autant être mauvais, plus proches en cela de ceux de la première saison. L’occasion de retrouver plusieurs ennemis déjà vus, de Metalo à Toyman en passant par Bizarro ou bien encore les Kryptoniens Mala et Jax-Ur. Les supers-héros ne seront pas en reste avec l’apparition de Robin, Aquaman, Green Lantern ou La Légion des supers-héros.
Proposant des scénarii travaillés, une bande son héroïque et une animation de qualité, la série se distingue aussi par son superbe design art deco. On notera également que le Superman de TAS se montre moins puissant que dans les comics en peinant par exemple pour soulever un «simple» camion. L’idée a énormément de sens dans une série animée portée par ses méchants et ses affrontements, ceci jouant nettement sur le rythme, le spectaculaire et la notion de suspens qui n’est dès lors plus simplement liée à l’utilisation de la Kryptonite. Précisons pour terminer qu’en 2006 (six ans après l’arrêt de la série) sortira le film Brainiac Attacks, sympathique mais qualitativement en deçà de ceux de Batman : TAS, Batman Contre le Fantôme Masqué ainsi que Batman et Mr. Freeze : Subzero.





Portée par d’excellents épisodes, une impressionnante galerie de supers-vilains, un superbe design et un doublage (anglais comme français) d’exception, Superman : The Animated Series rivalise sans peine avec Batman : The Animated Series. Proche des comics, intelligente dans son traitement, variée, elle réussit le tour de force de présenter un homme d’acier charismatique, à la fois plus fragile et intelligent.