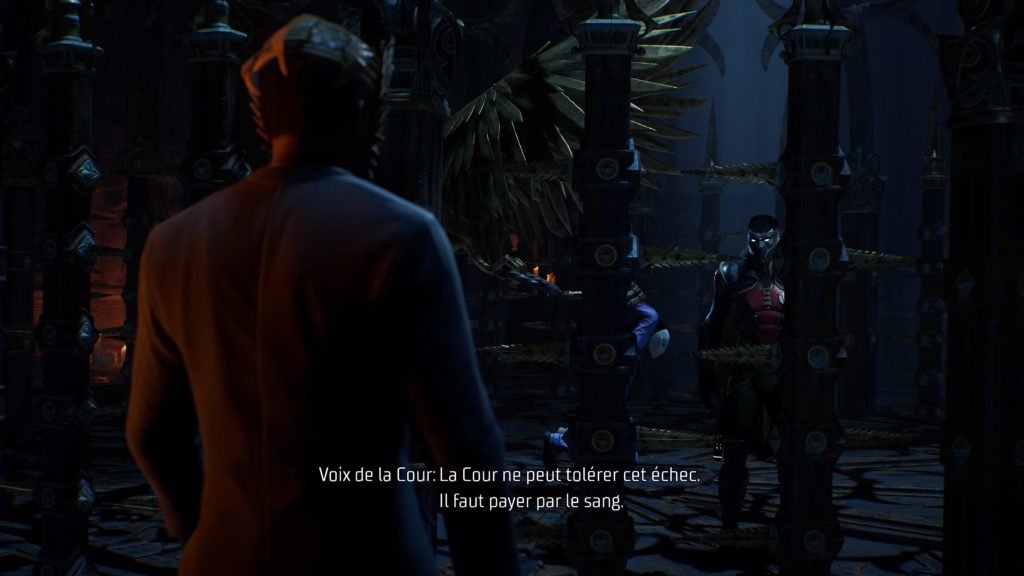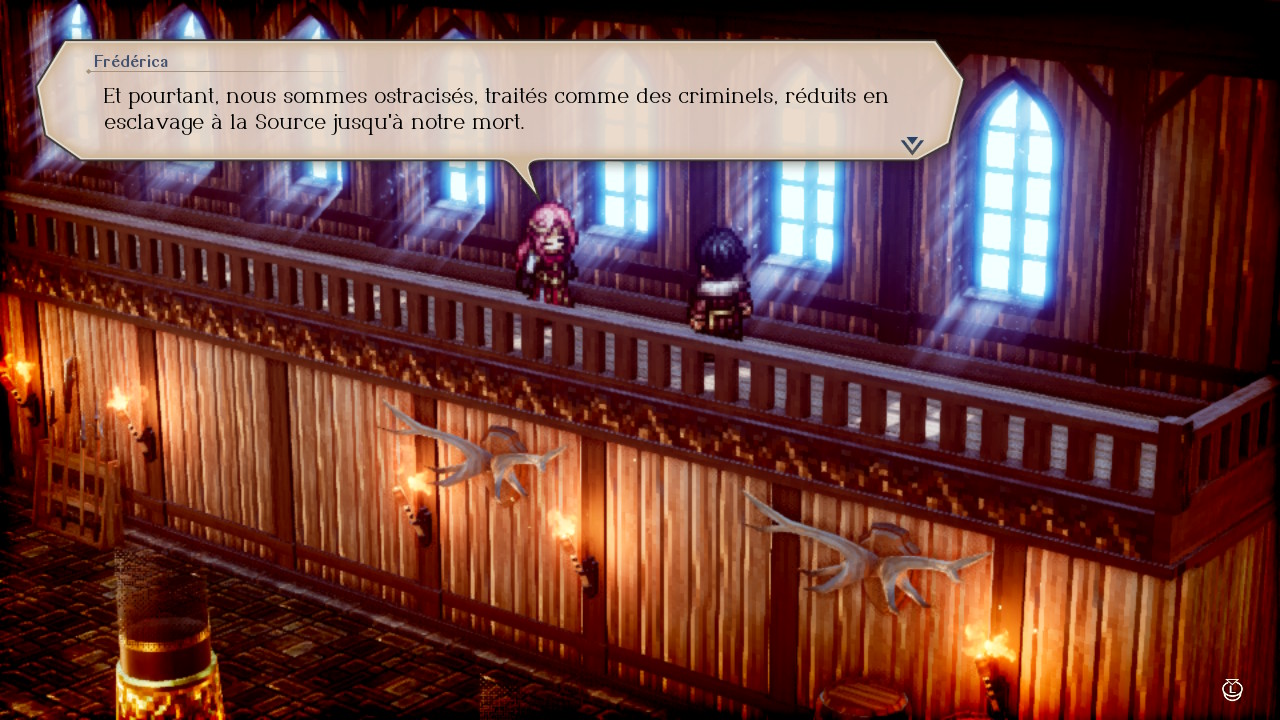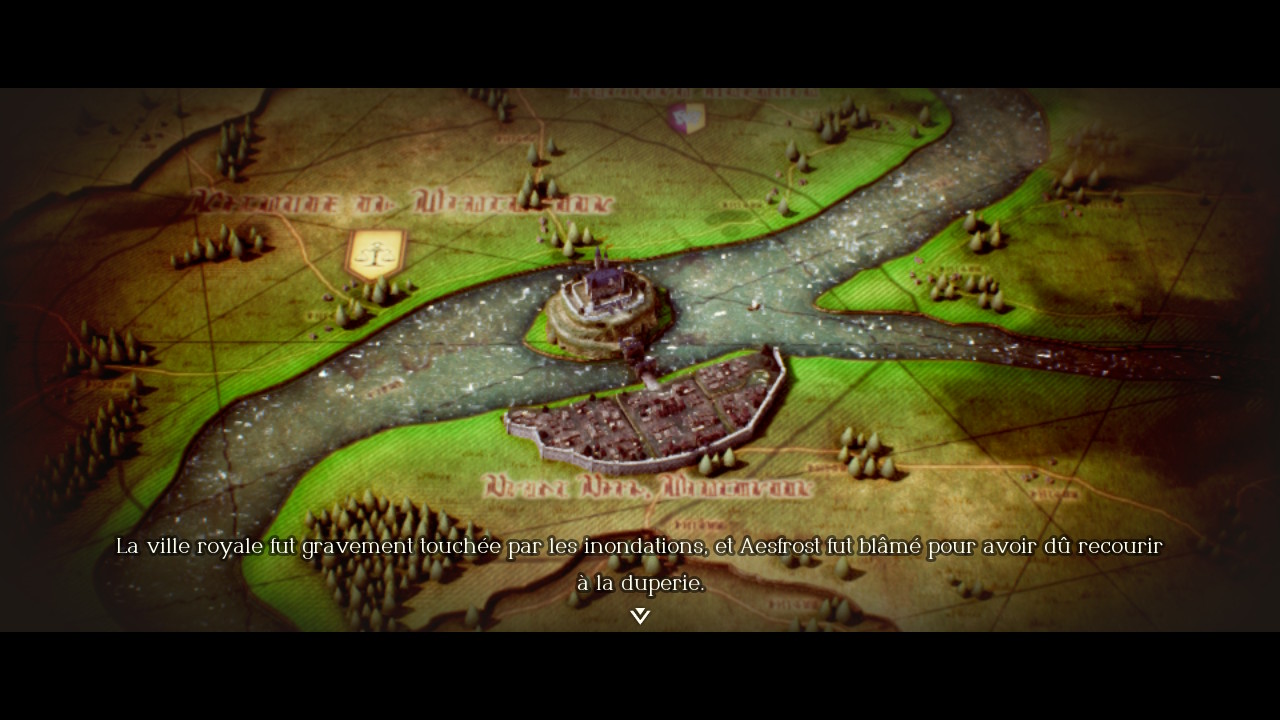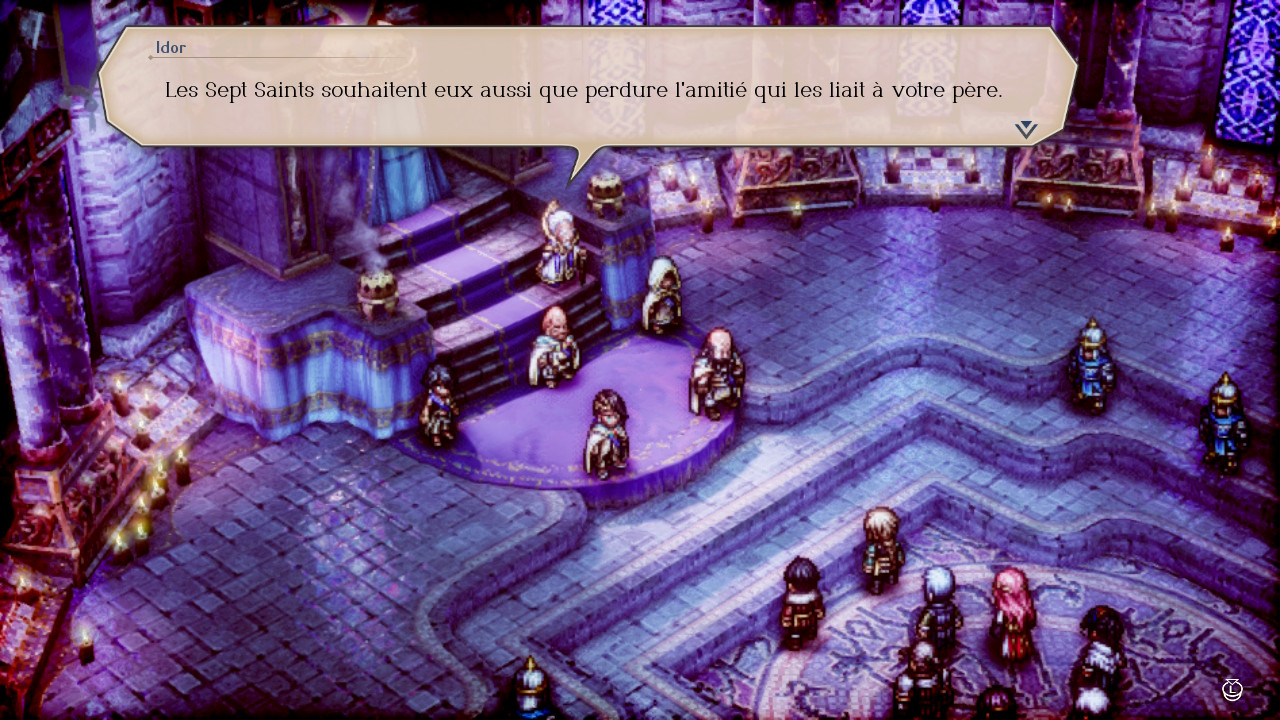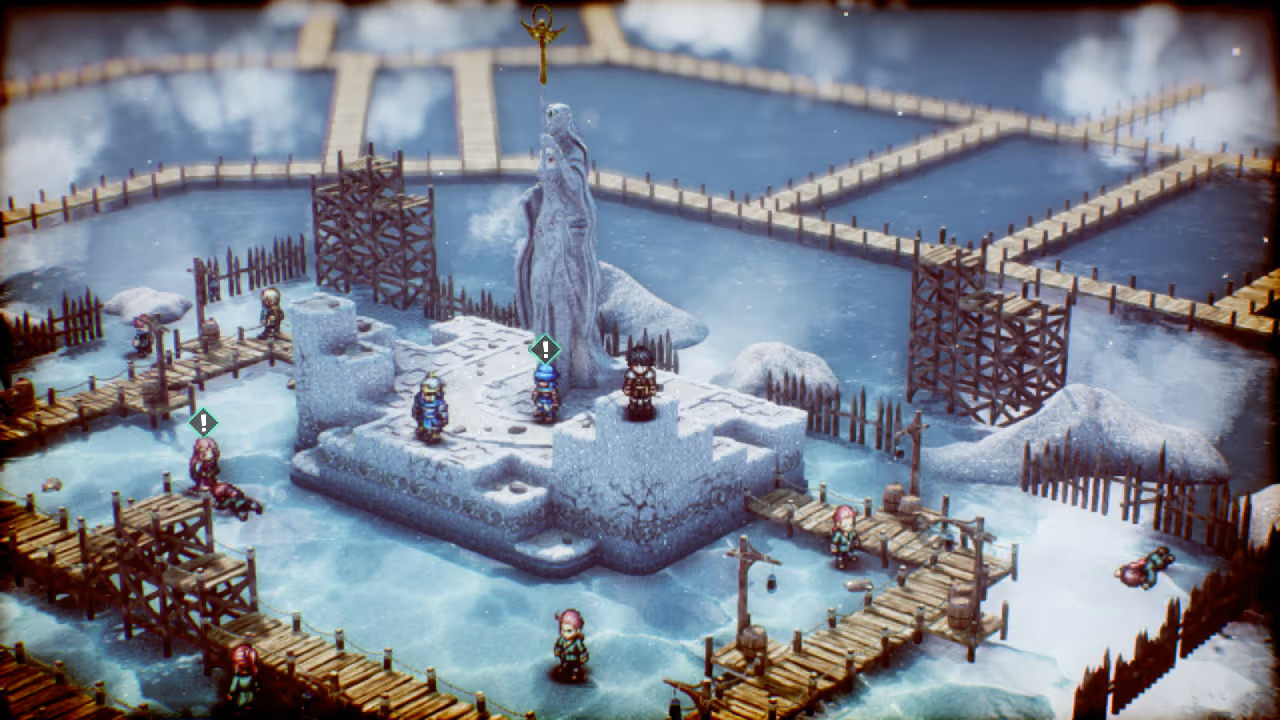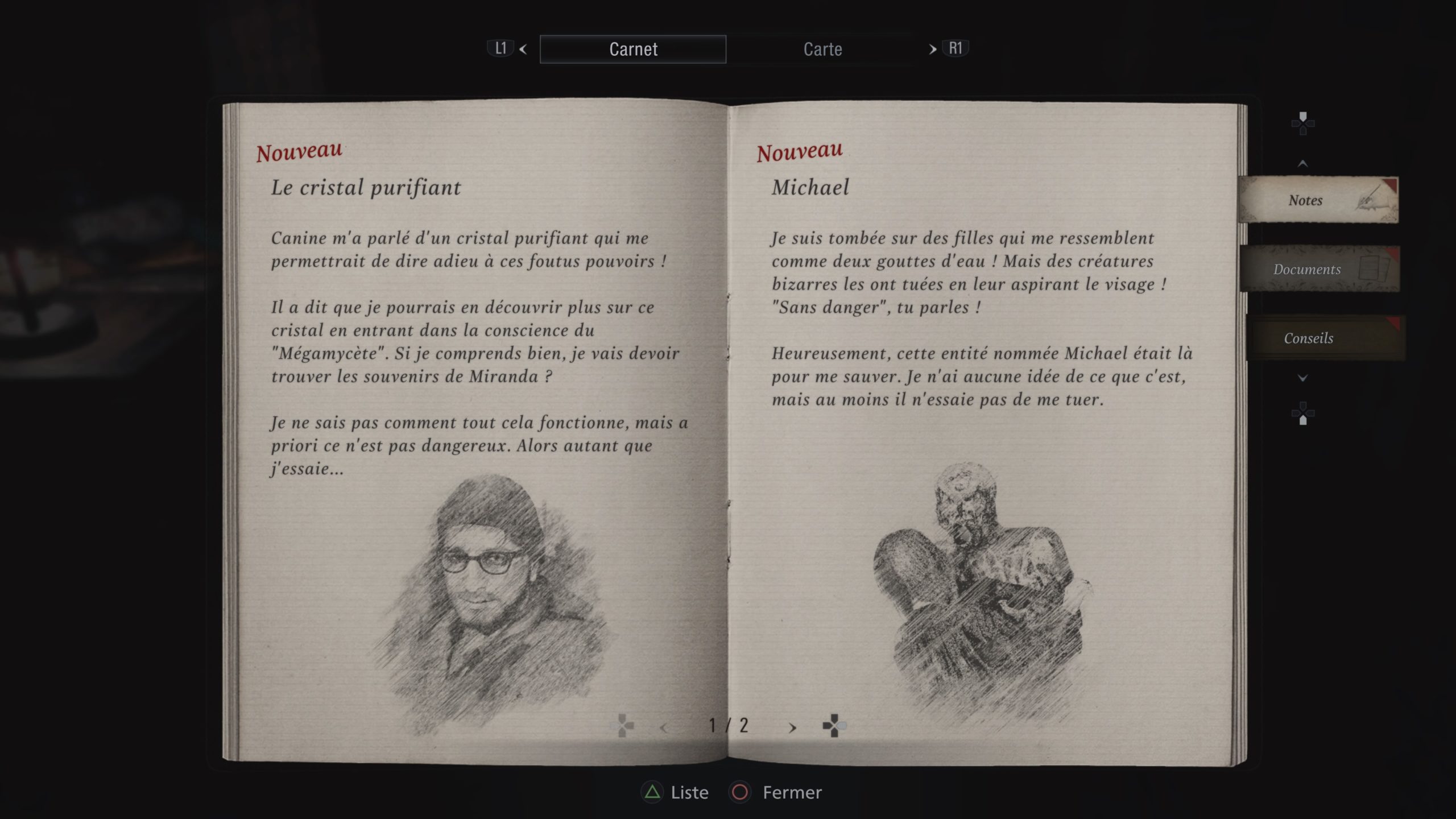L’histoire d’Aloy ne fait que débuter. La fin d’Horizon Zero Dawn le laissait présager, Forbidden West nous le confirme. Pour en connaître davantage sur son histoire, et accessoirement sauver une nouvelle fois son peuple, notre chasseuse part pour l’Ouest des Etats-Unis. Le début d’une nouvelle et très longue aventure… trop sans doute.
Cinq ans après nous avoir étonné avec leur premier open world aussi maîtrisé techniquement que plaisant à décourir, le studio néerlandais Guerrilla Games remet le couvert avec une suite bien plus généreuse que son aîné. Fondé sur les bases de leur précédent titre, Forbidden West nous plonge à nouveau dans un univers post-apo peuplé de machines robotiques. Si la surprise s’en est allée, le gigantisme de la zone de jeu et ce qu’il y a à y faire a de quoi donner le tournis. Une façon de faire popularisée par les open world d’Ubisoft mais générant un ressenti étrange, entre fascination et monotonie s’installant à mesure de la progression.
Un jeu qui a du coffre
Il est ainsi intéressant de revenir sur la structure de Horizon Fordidden West, reflet de ce qui se fait dans la quasi intégralité des jeux du même genre axant leur déroulé autour d’une exploration entièrement pensée à travers le loot. Toutefois, cet aspect prend une dimension plus importante dans Forbidden West réclamant beaucoup de craft afin d’obtenir différents types de flèches, les pièges indispensables en vue des affrontements à venir, etc. A cela, on ajoutera également bobines et autres matériaux pour booster les nombreuses armures à disposition. Si passées quelques heures, on a un peu de mal à s’y retrouver dans ce fourre-tout d’équipements (malgré un menu plutôt ergonomique), ouvrir les coffres disséminés un peu partout deviendra un automatisme.
C’est, à mon sens, un vrai problème (il ne se passe pas deux minutes sans que vous ramassiez quelque chose) d’autant que les développeurs l’assument pleinement en allant jusqu’à parsemer les zones de boss fights desdits coffres. Idéal pour casser l’immersion prisonnière de ce parti pris quelque peu agaçant d’autant qu’il faut y rajouter la collecte de branches, de baies et des innombrables logs écrits et audio venant enrichir le lore. Un problème du précédent jeu qui n’a malheureusement pas été résolu. D’ailleurs, si Forbidden West a agrémenté son histoire de quantité de dialogues synonymes d’une grande variété de quêtes, principales comme annexes, la mise en scène, elle, est toujours aussi statique. Ainsi, au-delà de quelques passages référentiels (dont un, reprenant au plan près une scène du Predator de John McTiernan), les champs-contrechamps de Zero Dawn reprennent du service auréolés d’à peine plus de mouvements. En résulte une narration assez figée alors qu’elle s’avère plus ambitieuse que par le passé via, notamment, l’intégration de nouveaux personnages venant consolider le scénario du précédent volet.
Sur ce point, on appréciera ou non la dimension encore plus science-fictionnelle de l’ensemble évoquant par moments le passé de Superman. Malheureusement, tous les protagonistes ne sont pas tous aussi réussis et Guerrilla Games a semble t-il vu trop grand en essayant de raconter l’histoire d’Aloy sur fond de guerre entre plusieurs tribus. Tout ceci participe néanmoins à la construction de l’univers du jeu qui demandera une véritable implication du joueur afin d’en capter toutes les nuances.
Un monde de possibilités
Si l’histoire de Forbidden West sert de fil rouge à sa progression, elle s’avère finalement presque secondaire par rapport à son gameplay offrant une fois de plus un contenu gargantuesque. Alors que les quêtes principales feront avancer le scénario, vous pourrez à loisir obtenir des quêtes secondaires en discutant avec les NPC traînant dans les villages et aux abords. En plus d’être scénarisées, lesdites quêtes vous apporteront la plupart du temps de précieux matériaux ainsi que de l’équipement. A l’inverse, les Services personnels, Tâches et autres Contrats de récupération vous pousseront à éliminer diverses créatures, trouver tel objet, etc. En somme, l’objectif sera le même (obtenir des ressources et/ou du stuff) mais sans enrobage scénaristique.
En parallèle de ces quêtes qui jalonneront votre parcours, vous pourrez aussi affronter des guerriers lors de courses. Celles-ci vous réclameront une bonne connaissance des parcours (s’étalant sur trois tours) et un certain skill, l’usage de l’arc étant fortement recommandé pour ralentir vos adversaires. Poursuivons avec l’Attakth, sorte de jeu d’échecs dans lequel vous devrez déplacer des pièces afin de prendre l’ascendant sur votre adversaire. L’idée d’intégrer un jeu dans le jeu avait déjà fait ses preuves (Final Fantasy IX, The Witcher 3…) et si l’Attakth n’a pas l’intérêt du Triple Triad de Final Fantasy VIII, le tout a le mérite d’offrir un peu d’originalité et de fraîcheur. De fait, de village en village, vous rencontrerez des joueurs de plus en plus forts mais aussi des règles différentes, basées, entre autres, sur plusieurs types de surfaces infligeant bonus ou malus à vos pièces.
Mentionnons enfin les fosses de combat permettant de débloquer de nouveaux mouvements, les camps de rebelles à cleaner ou bien encore les zones de chasse, déjà présentes dans le précédent volet et qui, en plus d’aiguiser vos talents de chasseuse à travers différents défis, vous permettront d’obtenir matériaux et équipements de qualité.
Chasse gardée
Embrayons par une fantastique pirouette sur la chasse, au centre du gameplay de la saga Horizon. Si le premier épisode était perfectible sur bien des points, ses phases d’action permettant aussi bien l’approche furtive (recommandée) que bourrine, fonctionnaient parfaitement grâce à une multitude de bonnes idées et d’excellents choix de game design tout en demandant aux joueurs de passer par une phase d’apprentissage afin de ne pas finir embroché par la première machine venue, surtout dans les plus hauts niveaux de difficulté. Tout ceci est bien entendu repris dans Forbidden West et enrichi de quelques nouveautés. On appréciera donc toujours autant le ressenti arc en mains, tant Guerrilla Games est parvenu au juste équilibre entre précision et sensation de puissance, entre la stratégie et l’excitation d’une chasse.
Malgré la résistance des machines les plus imposantes, on se sent véritablement à la place du chasseur et non de la proie. La satisfaction d’échafauder une tactique en truffant la zone de pièges est toujours là, scanner les ennemis afin de découvrir leurs points faibles, choisir nos armes (arcs, lances…) afin de gagner en efficacité fera aussi partie du plaisir. Si le combat au corps à corps profite lui aussi de quelques mouvements inédits, on privilégiera toujours les attaques à distance contre les machines. On prendra alors son temps pour débloquer les compétences dont on a besoin parmi six arbres distincts (Guerrier, Trappeur, Infiltré, Chef des machines…), analyser son environnement, préparer le terrain et assister au résultat tapis dans les hautes herbes.
Les affrontements contre les rebelles ont eux aussi gagné en intensité même si ils ont toujours moins d’intérêt que les parties de chasse profitant d’un bestiaire étoffé (mammouths, ptérodactyles…). Toutefois, afin de varier les approches, on usera au mieux des bonbonnes explosives pour affaiblir les guerriers adverses, on ne se priera pas pour retourner les machines captives contre leurs agresseurs et on mettra à profit les nouvelles possibilités (voile ascensionnelle, plongée) pour surprendre tout ce beau monde.
Bigger and better ?
Dans l’absolu, Horizon : Forbidden West coche toutes les cases de la suite réussie en additionnant nouveaux environnements, dont une magnifique San Francisco délabrée, les restes de la forêt de Yosemite ou la visite des fonds marins, gameplay amélioré, direction artistique somptueuse (impliquant à elle seule le fait de passer des heures dans le mode Photo pour mitrailler chaque nouveau biome) et technique au diapason. Certes, on pourra toujours lui reprocher une certaine forme d’immobilisme dans tout ce qui touche à sa narration (autant dans la mise en scène statique de ses dialogues que la façon laborieuse de développer son lore autrement que par le biais de centaines de collectibles) mais rien qui n’empêche véritablement de profiter de l’aventure, de s’y plonger à corps perdu.
Cependant, à y regarder de plus près, et au risque de me répéter, on sera aussi très souvent confrontés à l’ambition gigantesque des développeurs synonyme d’un open world sans doute trop vaste, trop dense, trop bourratif, ceci pouvant minimiser par moments, non pas la crédibilité du monde de Forbidden West, mais l’implication du joueur dans la quête principale noyée sous d‘épaisses couches d’activités annexes. Ressenti très personnel, j’en conviens, mais légitimant sans doute une réflexion sur le devenir d’un genre prisonnier de son besoin de toujours proposer davantage que le concurrent. Ghost of Tsushima nous a démontré qu’un open world pouvait vivre grâce à la magie insufflée à travers sa direction artistique, plus que par son contenu à proprement dit, on espère que le prochain volet d’Horizon saura tirer profit de cette leçon. En attendant le premier DLC qui devrait nous ouvrir les portes d’une nouvelle zone, cette suite n’en reste pas moins un grand jeu, imparfaite dans sa générosité (aussi paradoxal que cela puisse paraître) mais très souvent mue par des éclairs de génie, son incroyable gameplay et le charisme de son héroïne.





Profitant de fondations solides, Forbidden West améliore son gameplay, agrandit la taille de sa map et se pare d’ambitions revues à la hausse. Le point positif de tout ceci est qu’il en ressort une fois encore un grand jeu. Le revers de la médaille est que ce monde est justement trop vaste et qu’on a souvent l’impression de retomber dans les travers d’un Assassin’s Creed avec cette volonté absolue d’offrir toujours plus de contenu quitte à noyer complètement le joueur sous des excès de loot, des dizaines de quêtes et ce jusqu’à saturation. Malgré tout, la découverte de l’univers s’avère toujours aussi passionnante même si on aurait apprécié un scénario et une narration plus maîtrisés à même de supporter l’exploration de ce monde en friches aussi superbe visuellement que dangereux à arpenter.