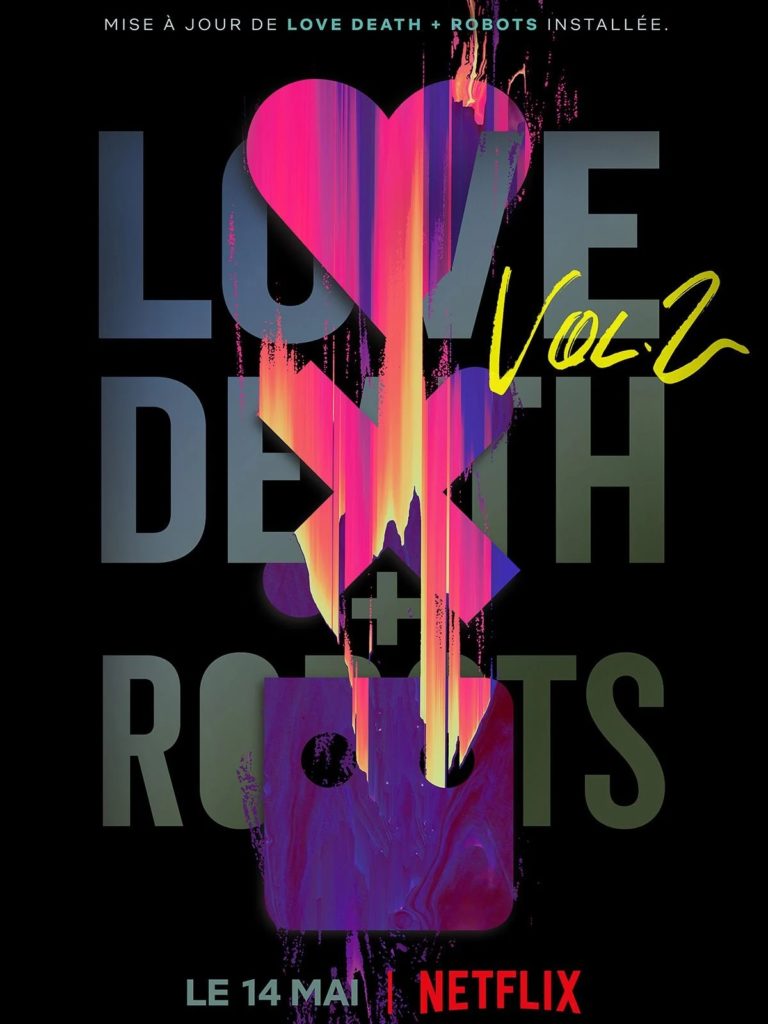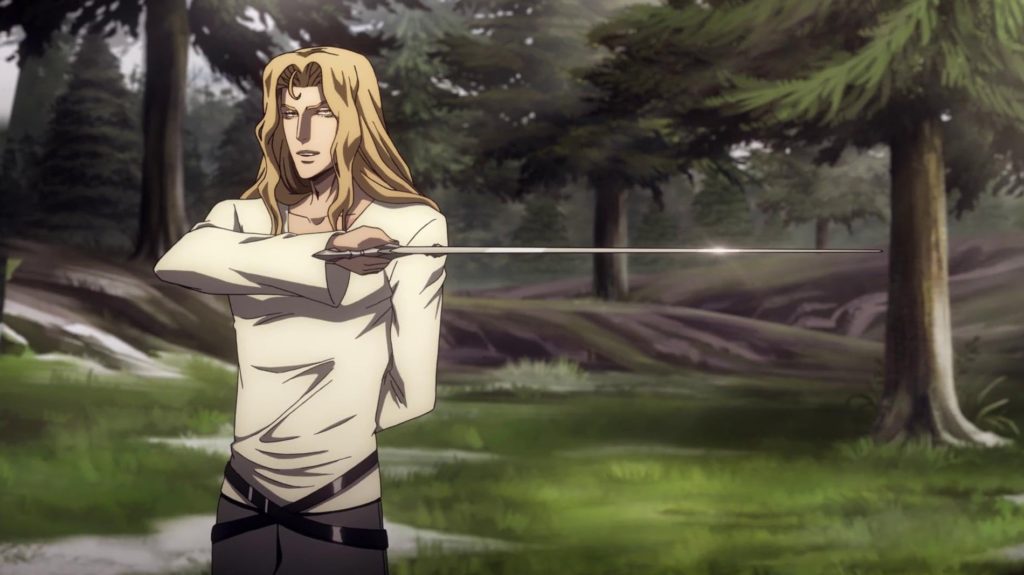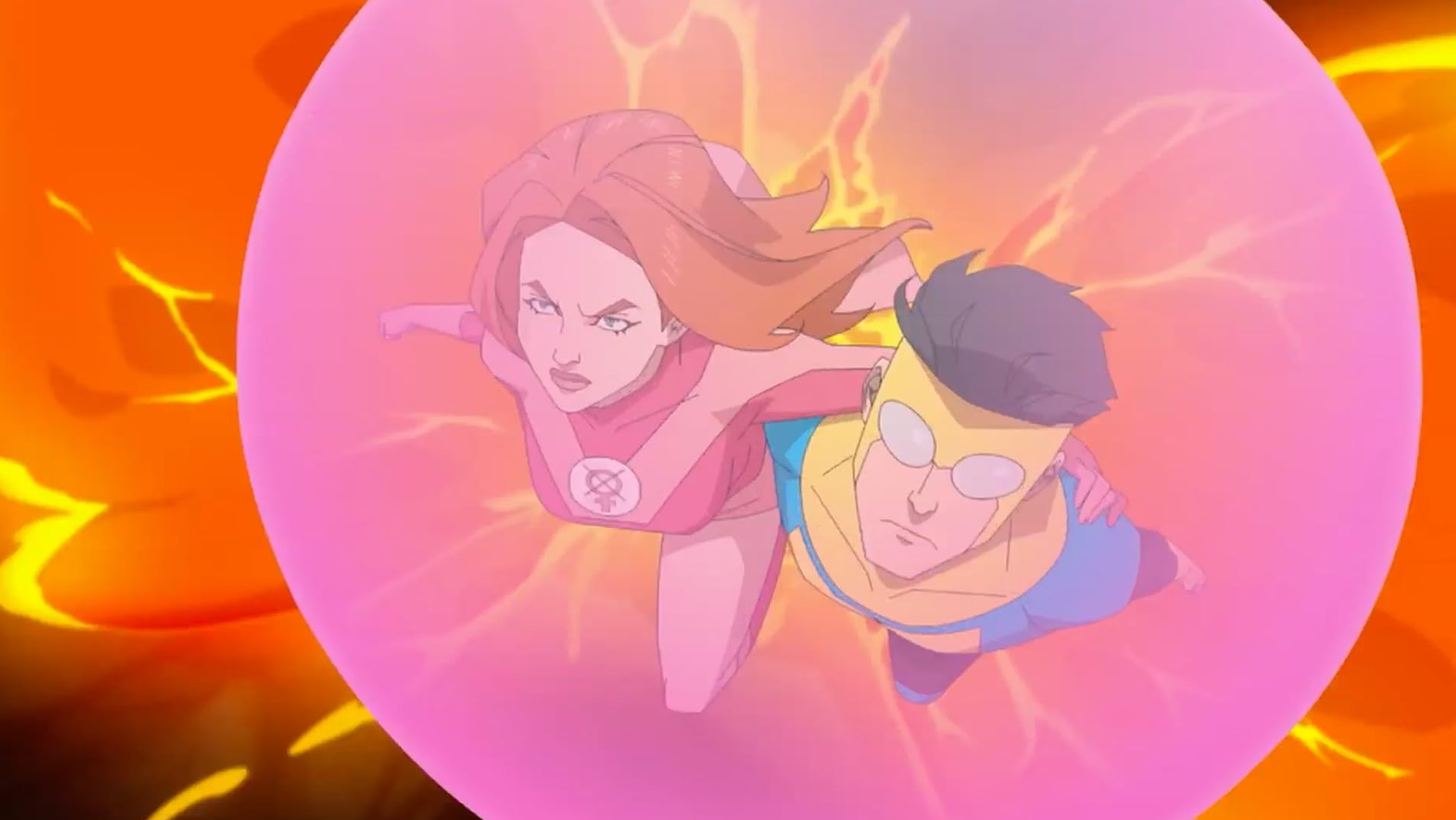Après s’être aventuré ces dernières années dans le genre super-héroïque, Zack Snyder revient au film de zombies, 17 ans après le brillant remake du Zombie de George A. Romero. Sa vie ayant été émaillée de déconvenues professionnelles et de tragédies personnelles, ce nouveau long-métrage, qui n’aurait pu être qu’un simple roller coaster truffé d’action, affiche les stigmates d’une vie récente n’ayant pas été de tout repos. Cependant, Army of the Dead, se situant à la croisée des chemins d’Aliens et d’Ocean’s Eleven, porte également en lui un douloureux constat : tout le mordant du cinéma de Snyder est ici inversement proportionnel à celui de ses macchabées.
Le problème principal de Army of the Dead ne vient pourtant pas de son scénario bien que celui-ci soit perclus d’incohérences. En effet, dès le départ, le projet se présente comme un réjouissant film de zombies dans lequel le personnage campé par Bautista va devoir former une équipe de choc pour aller effectuer un casse à Las Vegas, désormais no man’s land coupé du monde par une immense palissade afin que les milliers de zombies qui s’y terrent ne puissent en sortir. Pour rajouter un peu de piment, la ville, à l’instar de Raccoon City (Resident Evil 3), est promise à une destruction totale via un bombardement nucléaire imminent. Évoquant aussi bien New York 1997 (dans son pitch de départ) qu’Ocean’s Eleven ou Aliens, auquel il emprunte quantité d’éléments, tout laissait présager un spectacle bas du front mais oh combien jouissif d’autant que Snyder n’a plus à démontrer ses compétences lorsqu’il s’agit d’aligner plans iconiques et action démesurée. Sauf qu’ici, rien ne fonctionne vraiment. Le montage chaotique, la photo abominable du film (jonglant constamment entre flous et sous-exposition), des personnages stéréotypés au possible, rien ne va. Plus grave, alors que le film aurait gagné à jouer la carte du second degré du début à la fin, il se prend trop souvent au sérieux en intégrant notamment une histoire entre Scott Ward (Dave Bautista) et sa fille, ainsi qu’une ébauche de love story avec Geeta, jamais correctement développées et donc totalement dispensables, si ce n’est pour rallonger la durée du film qui aurait gagné à être écourté d’au moins trente bonnes minutes.
Cet exemple ne fait que mettre en avant tout ce qui ne va pas dans le film, d’une écriture catastrophique à un agencement de séquences couvert d’ellipses et de maladresses. On retiendra, à ce sujet, un temps d’incubation très variable ou l’introduction avec ce convoi militaire, seul sur une route du Nevada et arrivant tout de même à se prendre l’unique voiture arrivant en sens inverse. Aussi involontairement drôle que la scène de Lori Grimes dans The Walking Dead, la séquence laisse ensuite sa place à un générique très réussi, rare moment où l’on retrouve les fulgurances visuelles auxquelles nous a habitué le réalisateur. Malheureusement, aussi percutante soit-elle (dans tous le sens du terme), l’introduction pointe du doigt les innombrables blancs du scénario à commencer par les origines d’Alpha (la cargaison des militaires) jamais évoquées bien que centrales dans l’univers qu’on nous dépeint. Comment a-t-il été créé ? Qu’est ce que l’armée comptait en faire ? Existe-t-il d’autre foyers pandémiques dans le monde ? Aucune de ces questions ne sera finalement abordée.
Il faudra simplement accepter cet état de faits, tout comme celui qu’il existe des zombies lambda (bêtes, méchants et affamés) et des zombies doués de raison, formant une meute coordonnée et menée par Alpha et sa reine, également sous-exploitée à l’image d’une autre piste scénaristique réjouissante renvoyant à Dawn of the Dead mais tombant très vite à plat. En somme, bien qu’amenant plusieurs options originales, les morts-vivants restent finalement cantonnés à leur fonction première : courir, rugir et fondre sur notre groupe de braqueurs qui ne sont guère mieux lotis. Clichés au possible, chacun se voit réduit à sa plus simple expression : le perceur de coffres, sûr de lui mais un brin maladroit, le mercenaire à la solde de Tanaka (le commanditaire du casse) ne laissant planer aucun doute sur sa nature, la latino badass, lointaine cousine de Vasquez (Aliens), la pilote d’hélicoptère fumant son cigare en faisant le plein de son appareil… Equipe disparate mais réunie autour de l’appât du gain, celle-ci n’arrive jamais à créer l’empathie, l’exposition des personnages, pourtant longue de 40 minutes, ne parvenant pas à offrir suffisamment d’épaisseur aux membres du groupe ou bien encore à créer l’étincelle à cause de scènes et dialogues mille fois vues et entendus. Que dire également de Kate Ward, enrôlée par son père pour une raison artificielle et ne perdant jamais une seconde pour prendre de mauvaises décisions en pleine action, et ce, même si elles sont guidées par l’envie de retrouver une personne disparue. A l’inverse, on sera agréablement surpris par le personnage de Lily, plus travaillé que ses comparses et profitant du jeu énergique de la Française Nora Arnezeder.
Bien que le film conserve quelques moments plaisants et de très beaux plans d’un Las Vegas post-apo, on trouvera frustrant qu’il n’use jamais véritablement de son décor pour jouer avec ou du moins varier les situations se déroulant la plupart du temps dans des intérieurs génériques. Dommage, tout comme pour la plupart de ses idées peinant à générer les émotions censées être véhiculées. D’une séquence très convenue semblant issue de Silent Hill : Revelations et I Am Legend, à une scène d’action brouillonne dans le casino en passant par une ouverture de coffre beaucoup moins spectaculaire que celle de Die Hard, pour ne citer que cette dernière, le film de Snyder échoue la plupart du temps à générer peur, excitation et rires. D’ailleurs, bien que le tout opère à certains moments des retournements à 180° afin de se la jouer un peu plus «fun and destroy», c’est également peine perdue à cause d’astuces aussi illogiques qu’improbables (le coup des zombies pour déjouer les pièges) ou de blagues (celle des macchabées portant des vêtements similaires à ceux du groupe) essayant de faire naître dans l’esprit du spectateur certains doutes pour mieux s’en amuser… A moins qu’il ne s’agisse ici de la première pièce d’un puzzle visant à développer l’univers du film de Snyder.





Blindé d’approximations et n’arrivant pas à créer l’empathie pour ses personnages, Army of the Dead n’use à aucun moment de ses meilleures idées (les zombies doués de raison) ainsi que de ses personnages les plus iconiques (le zombie Alpha et sa reine). Il préfère, pendant plus de deux heures, raconter une histoire qui aurait dû délaisser certains arcs narratifs ne faisant que court-circuiter son aspect B movie plus ou moins assumé. Jamais effrayant ni vraiment excitant dans son action, le film de Snyder se complaît dans ses références plutôt que d’user au mieux de ses éléments les plus notables qui, correctement mis à profit, auraient pu apporter un vent de fraîcheur au genre.