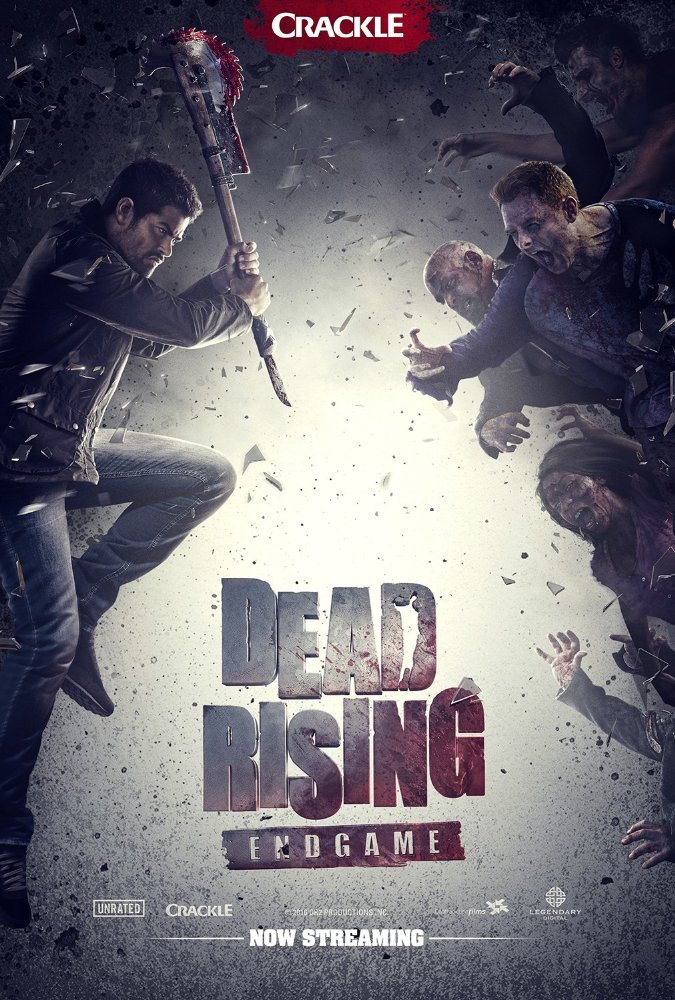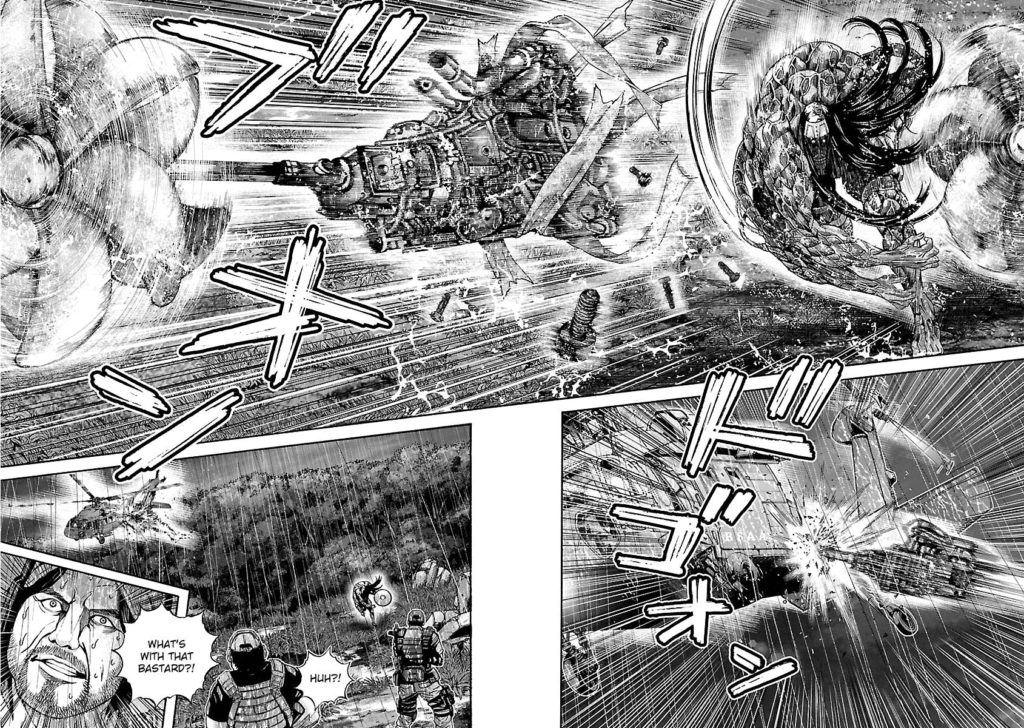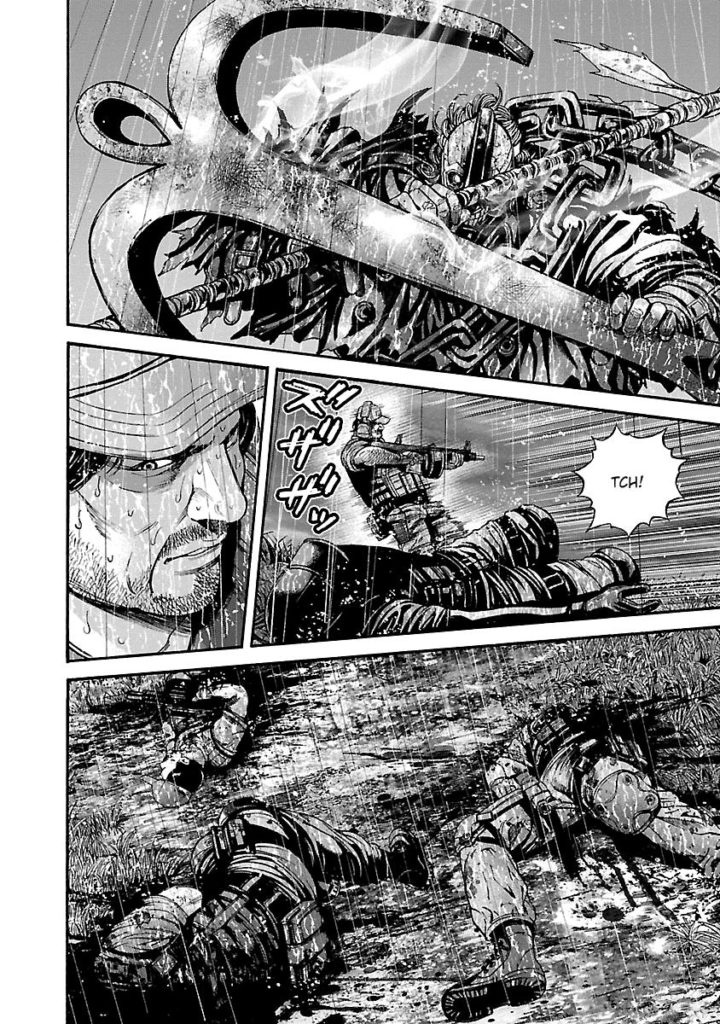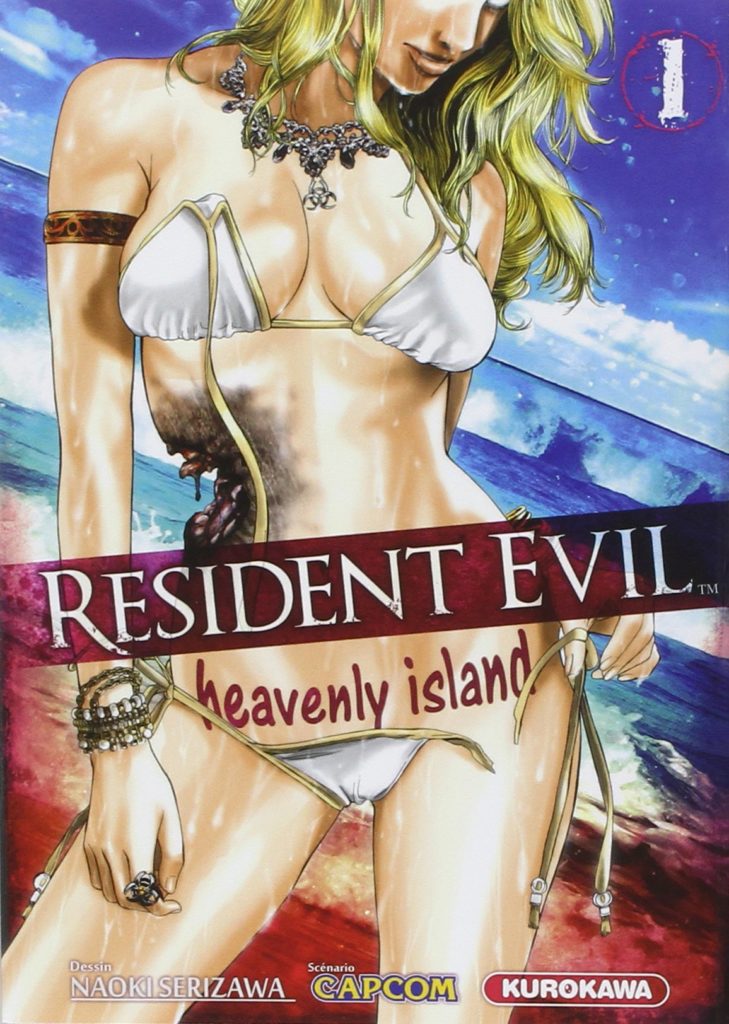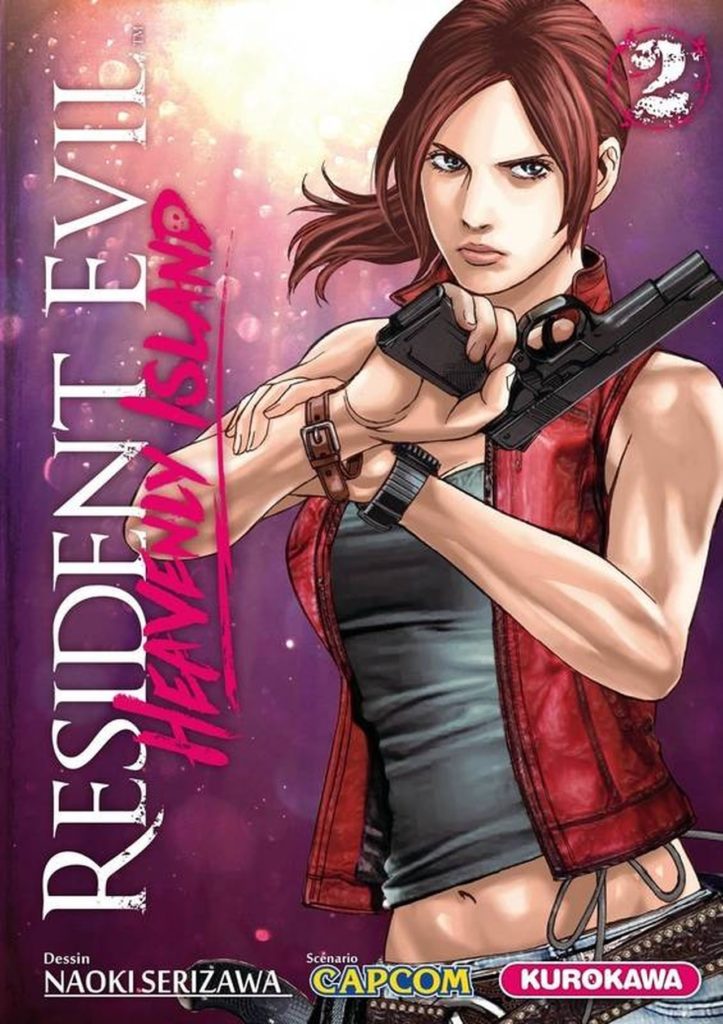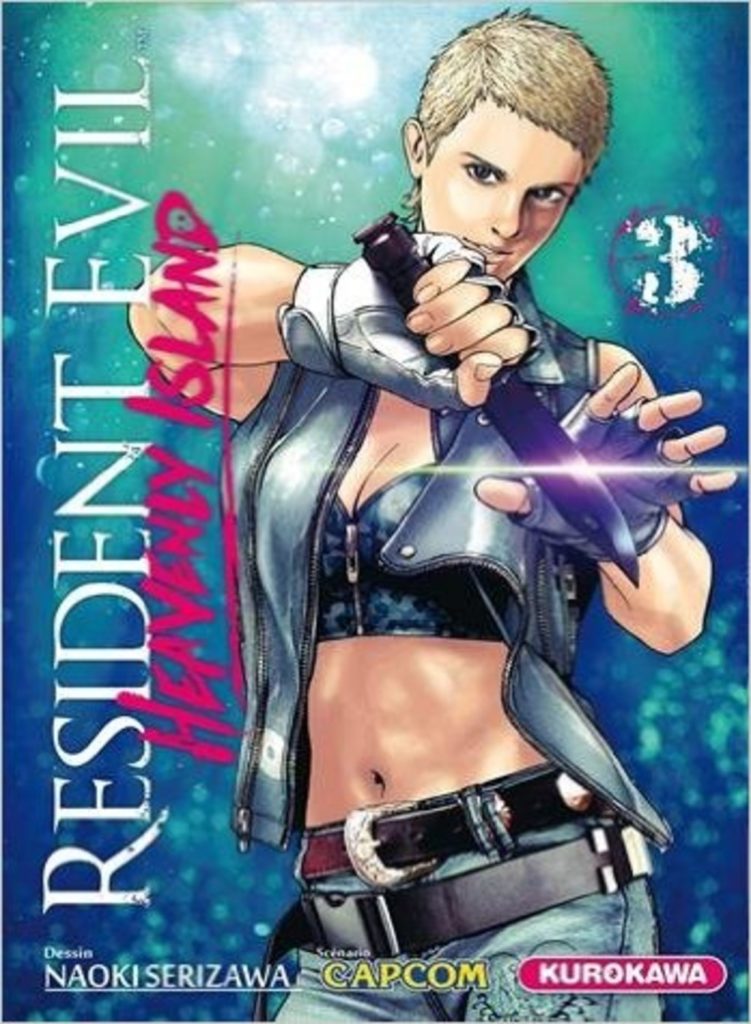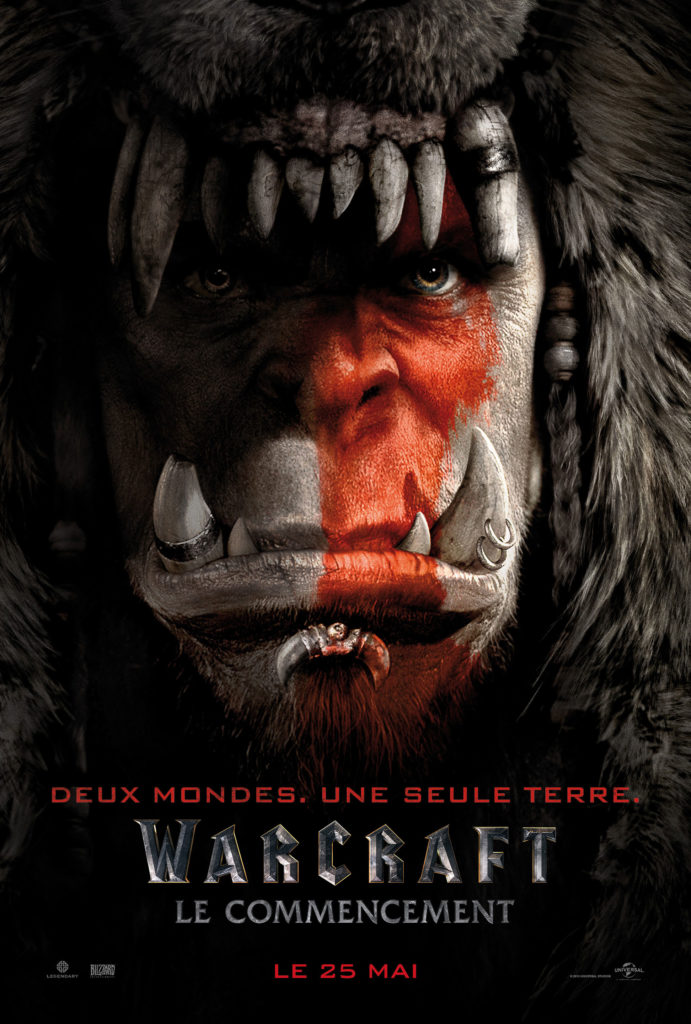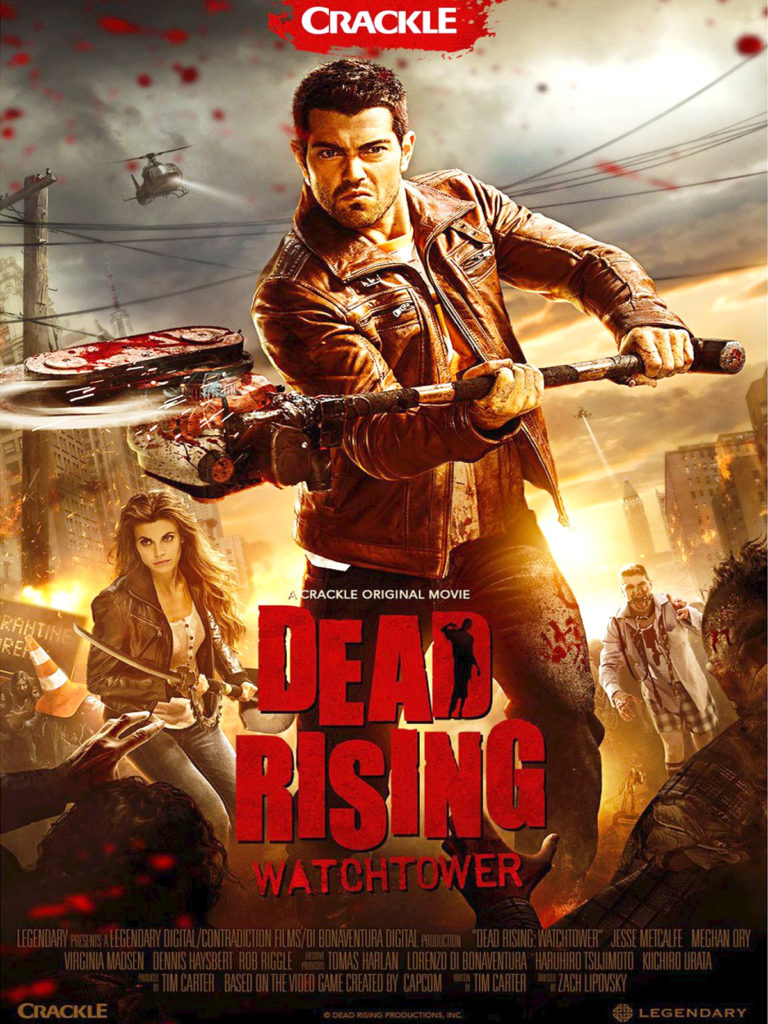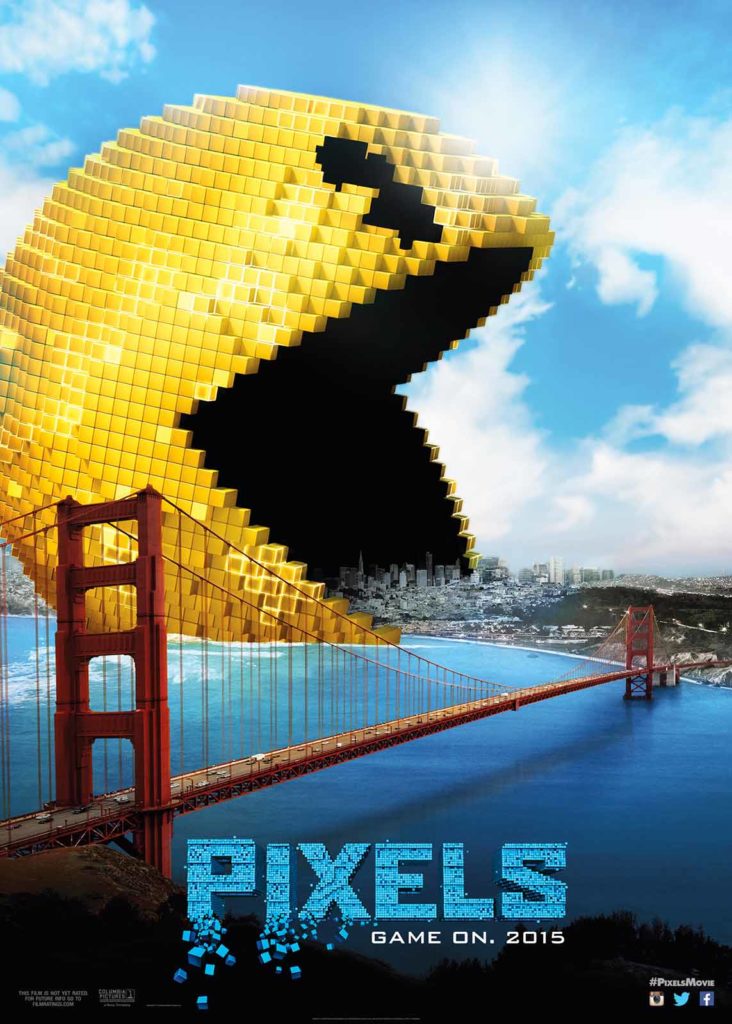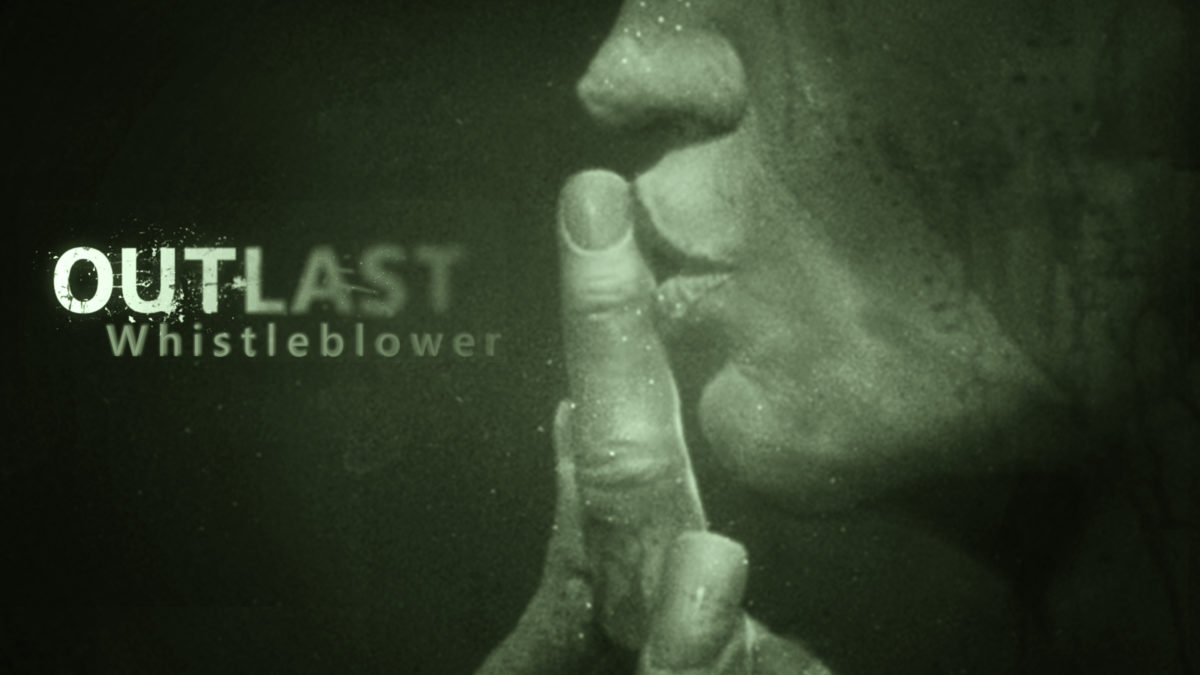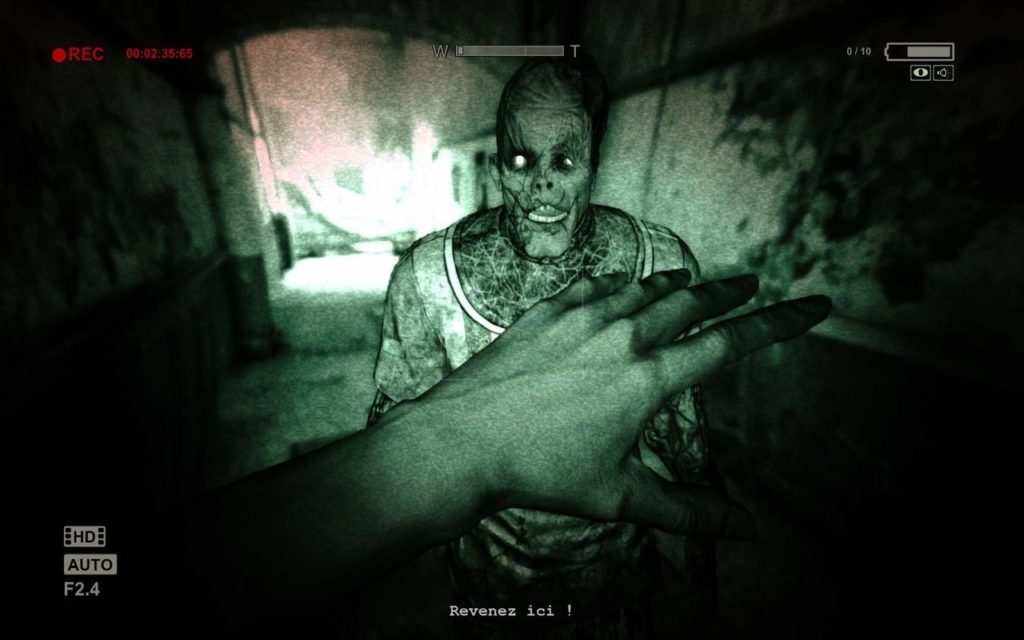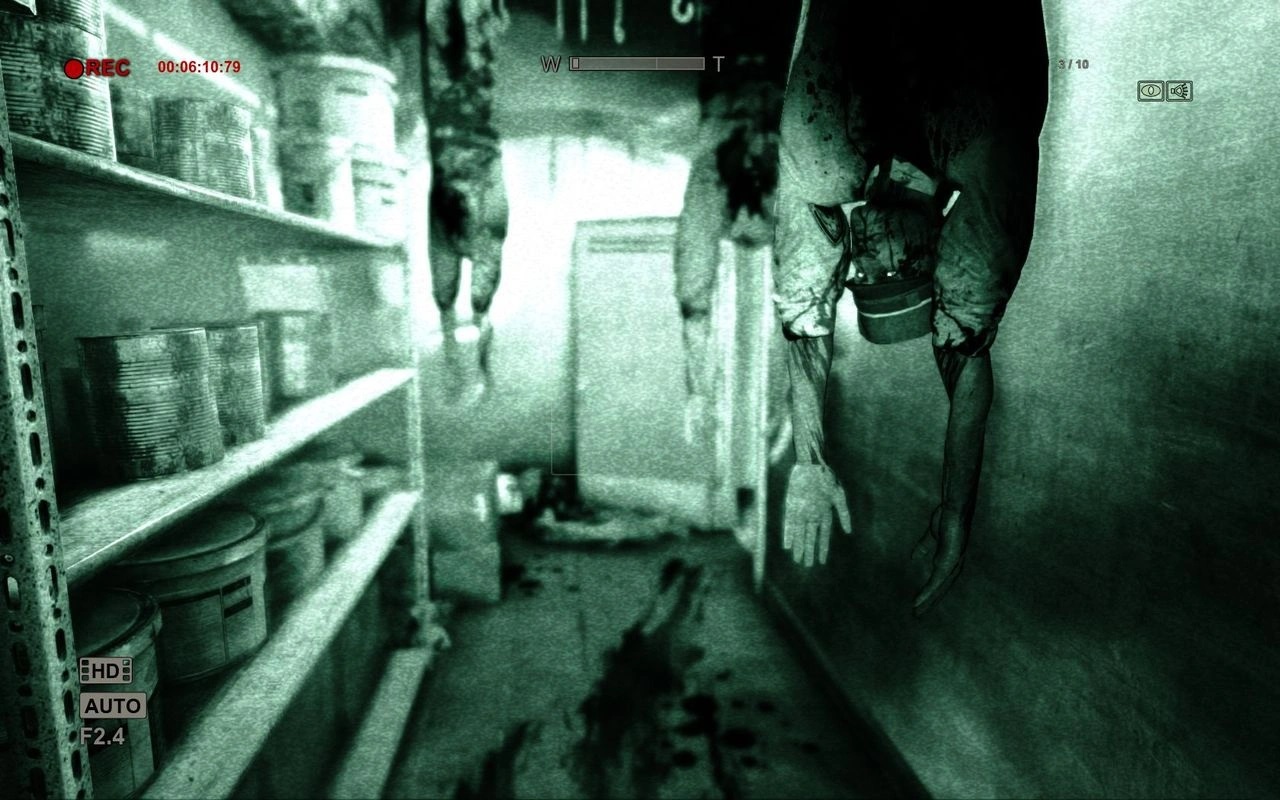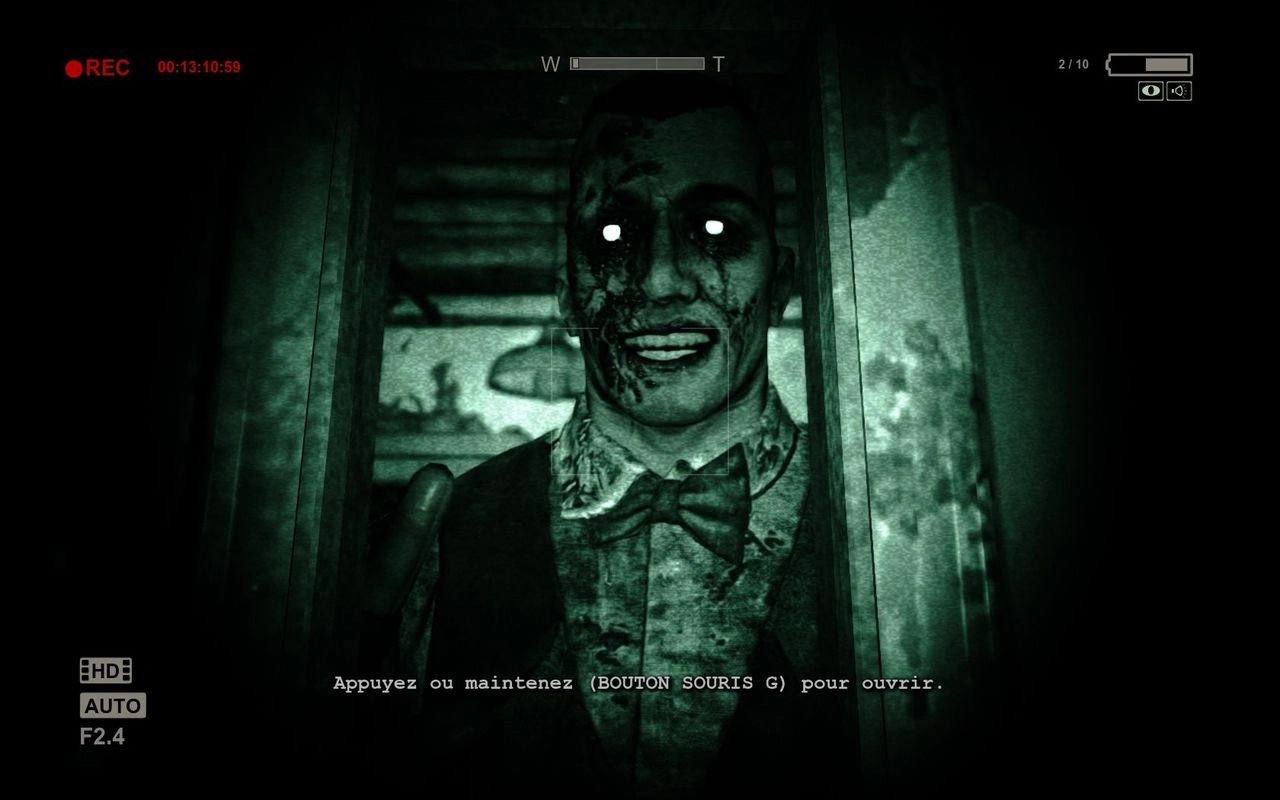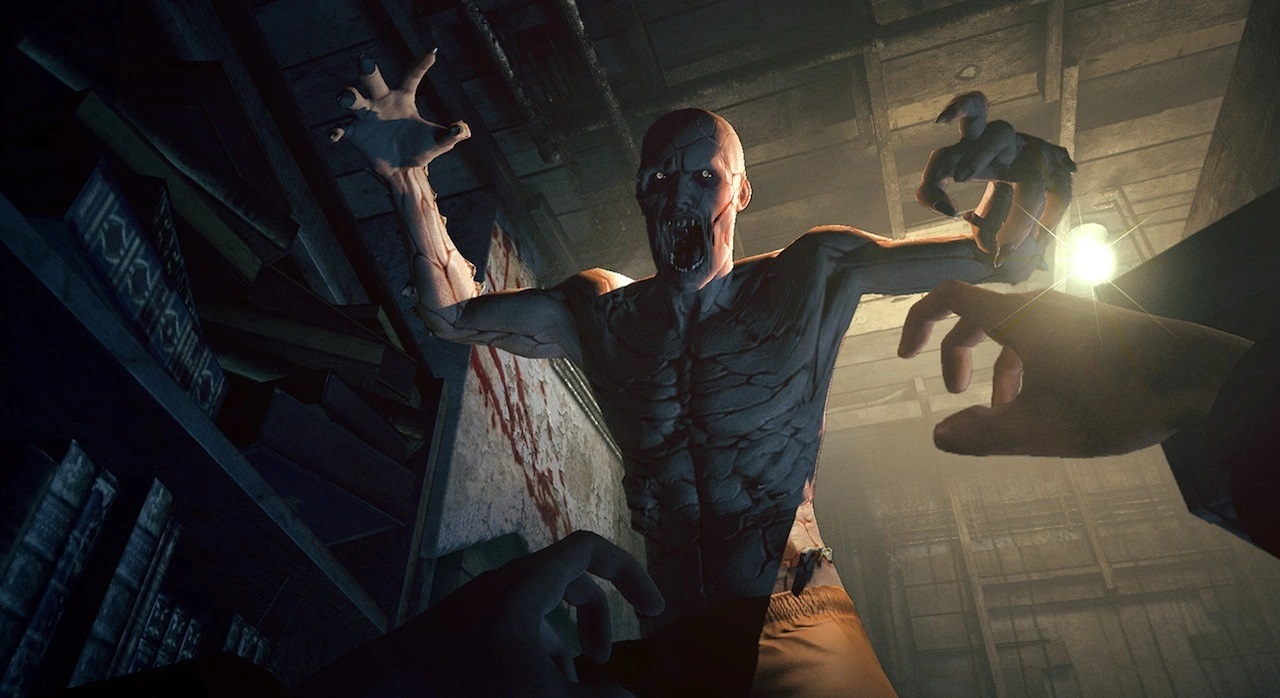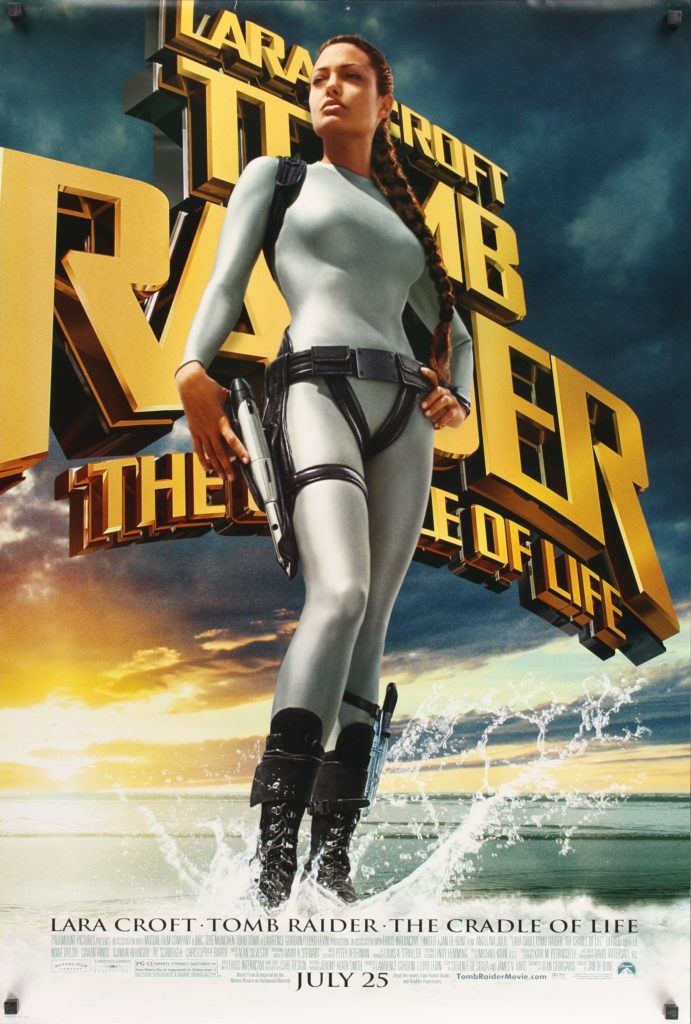Décomplexé au possible, Les Gardiens de la Galaxie avait apporté un véritable vent de fraîcheur dans le Marvel Cinematic Universe grâce à son ambiance rock ‘n roll, ses acteurs se démenant comme des beaux diables et son univers de SF coloré, sorte de contre-poids absolu à ceux plus sérieux de Star Wars ou bien encore Star Trek. Ayant généré de confortables bénéfices, sa suite était donc des plus logiques. Trois ans plus tard, ce Volume 2, toujours réalisé par James Gunn, vient crever l’écran en reprenant la formule initiale.
Comme on pouvait s’en douter, le second volet des Gardiens de la Galaxie reprend ce qui avait fait la renommée du précédent en multipliant tout ce qui fonctionnait par deux. Que ce soit la bande-son omniprésente ici composée de morceaux des années 70, l’humour ou l’action décomplexée, chaque élément de ce Vol. 2 en fait un Awesome Mix du film de super-héros familial.
Des super-héros roots pour une comédie groot
Mettant logiquement en avant un groupe plus soudé que jamais en allant piocher, le Vol. 2 intègre à nouveau Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot sous sa forme Baby (suite aux événements du précédent film), Drax et Gamora. Étonnamment, alors que le film réussit la prouesse d’offrir une place quasi similaire à tous les membres, il prend aussi le temps de réintégrer les personnages de Nebula (Karen Gillan) et Yondu Udonta campé par un Michael Rooker s’en donnant à cœur joie.
Si on pouvait craindre qu’avec tant de personnages, le film soit déséquilibré (à l’image d’un The Avengers : L’Ere d’Ultron), il n’en est rien. Au contraire, les relations entre les divers protagonistes sont bien plus affinées et donnent souvent lieu à des séquences drôles, punchy ou émouvantes. Malheureusement, le scénario fait également l’erreur de s’attarder sur Ego (Kurt Russell), père de Star-Lord, sans jamais prendre le temps de creuser comme il se doit le personnage.
Trop dense, le script se saborde de lui-même en ajoutant une énième intrigue avec Ayesha, Grande Prêtresse de Sovereign, n’ayant de cesse de poursuivre les Gardiens. Si les fans de comics auront bien entendu compris l’importance de son rôle (renforcé par la scène post-générique qui annonce d’ores et déjà un Vol. 3), le Grand public pourra trouver étrange la présence de la souveraine dont l’intérêt n’est finalement que d’amener deux ou trois gigantesques batailles spatiales évoquant par moments celles de Star Trek : Sans Limites.
Ce personnage, de par ce paradoxe entre son statut et son traitement à l’écran, est néanmoins caractéristique du ton de ce Vol. 2 qui oscille plus que jamais entre action débridée et blagues en rafale misant sur le bagou de Rocket Raccoon, la naïveté et la jovialité de Drax (formant un impropable mais savoureux duo avec l’extraterrestre Mantis) ou bien encore les sous-entendus entre Star-Lord et Gamora, un couple que tout semble opposer mais voué à se rapprocher au fil des péripéties. Bien que tous les traits d’humour ne soient pas du même niveau, James Gunn s’amuse à renforcer les liens entre les membres de l’équipe, à accentuer l’aspect familial du groupe et le film met la plupart du temps dans le mille, en multipliant les idées autour de Baby Groot ou via la savoureuse apparition de Stan Lee, sans doute l’une des meilleurs du MCU.
Comme un air de déjà-vu…
On peut tout de même ici se questionner sur la viabilité (d’un point de vue créatif) du modèle hollywoodien tant une suite se retrouve constamment engoncée entre un cahier des charges et le besoin de faire évoluer l’histoire et ses personnages. Si certaines sagas comme Star Wars, Alien ou Scream s’en sont sorties malgré de grosses déconvenues, Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 2 émerveille autant qu’il agace dans sa volonté absolue de reprendre à l’exact la formule du précédent film.
Si sur la forme, il n’y a pas grand chose à critiquer, l’excellente bande-son soulignant des effets visuels bluffants mis en exergue par la réalisation maîtrisée de Gunn, sur le fond, on pourra déjà émettre un peu plus de réserve. Il y avait sans doute matière par exemple à creuser davantage la relation entre Quill et son père ou à rendre la construction un peu plus homogène afin de minimiser l’effet «pot pourri de scènes éparses» bien que très drôles et renvoyant la plupart du temps à l’imagerie issue d’un comic-book survolté.






Spectacle réjouissant marquant qui plus est la rencontre de grandes action stars des années 80, décomplexé , drôle et très généreux, ce Vol. 2 aurait néanmoins gagné à prendre un peu plus de risques et à réduire plusieurs intrigues pour se focaliser sur l’essentiel.