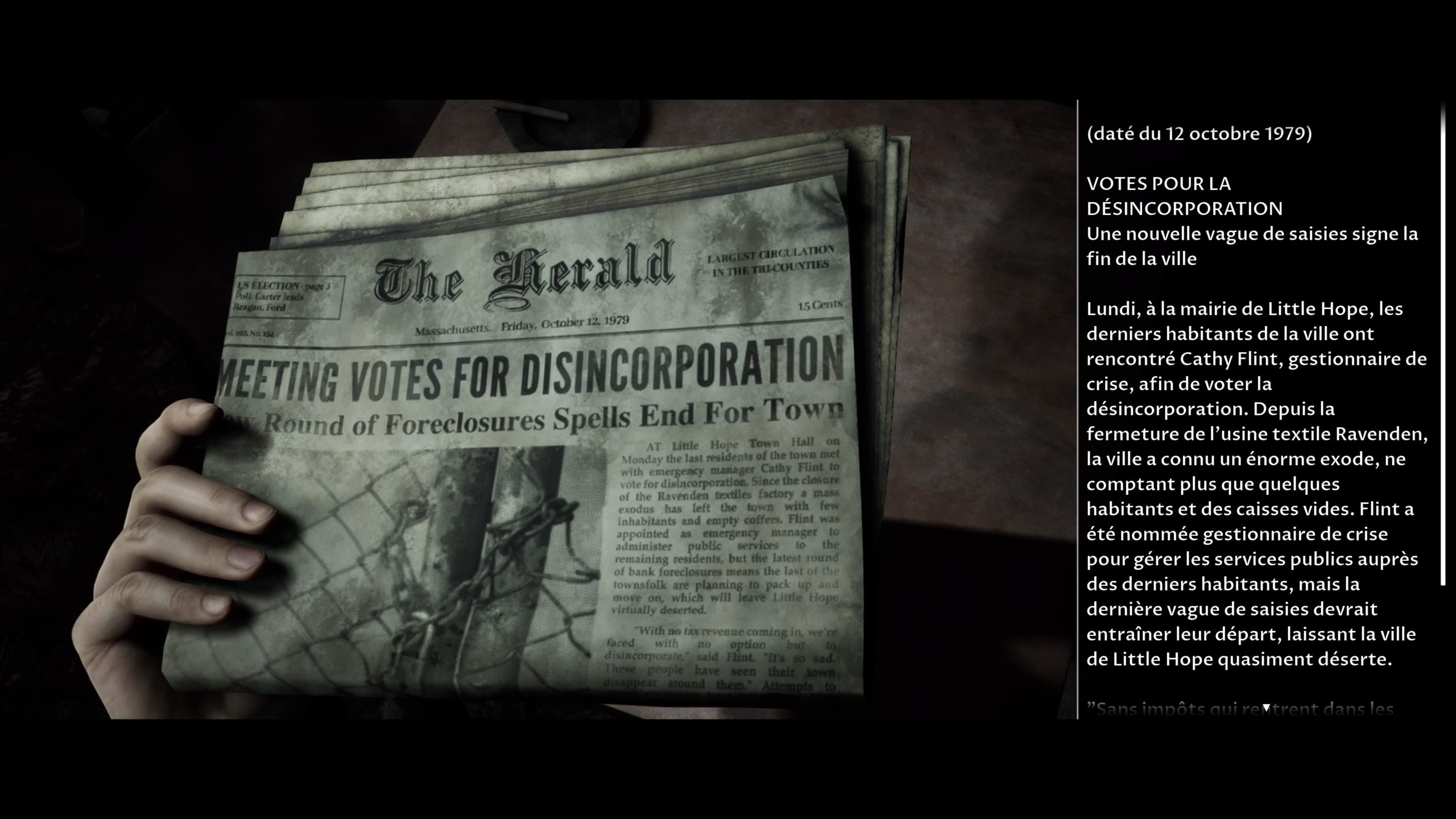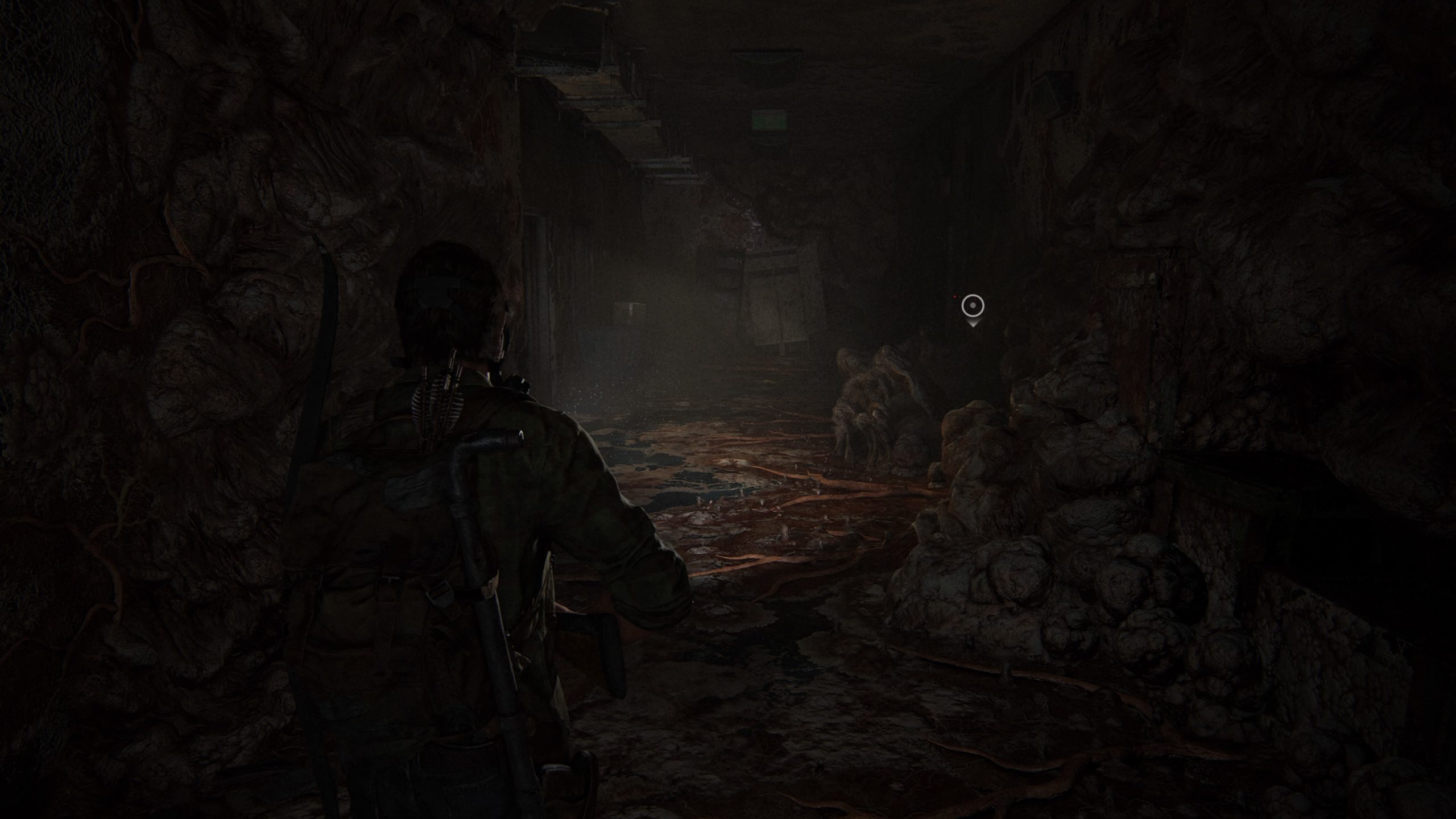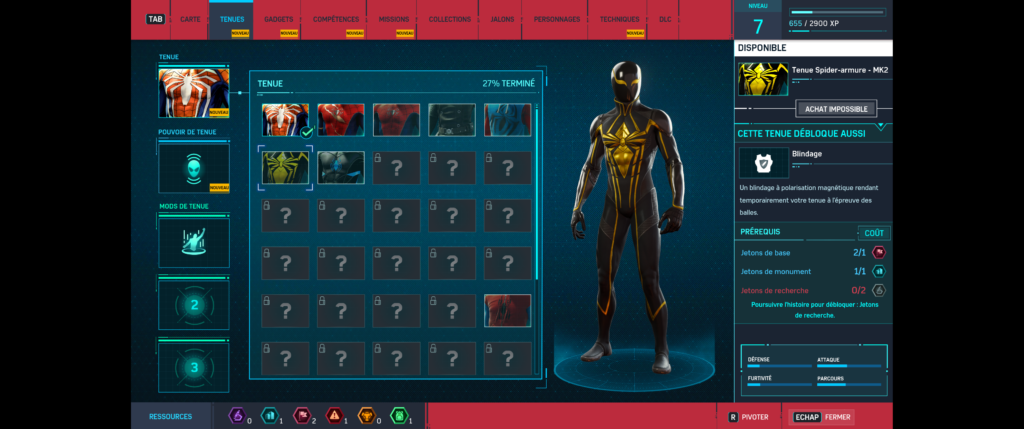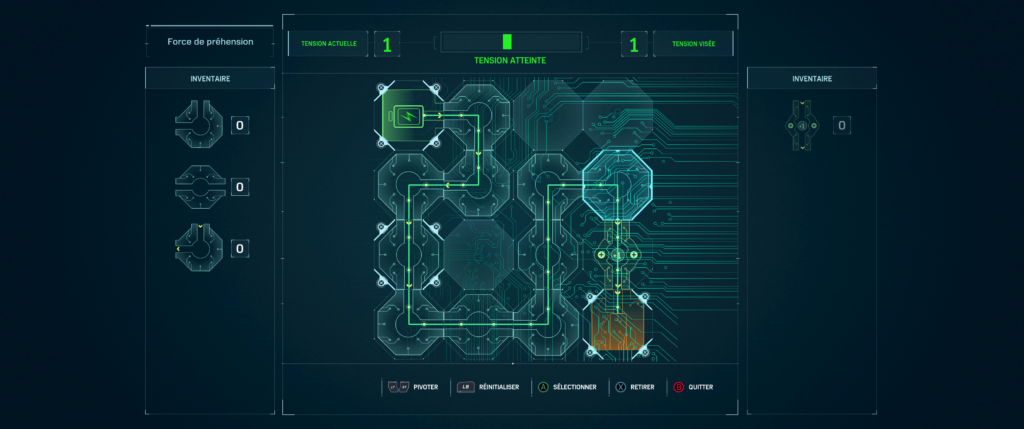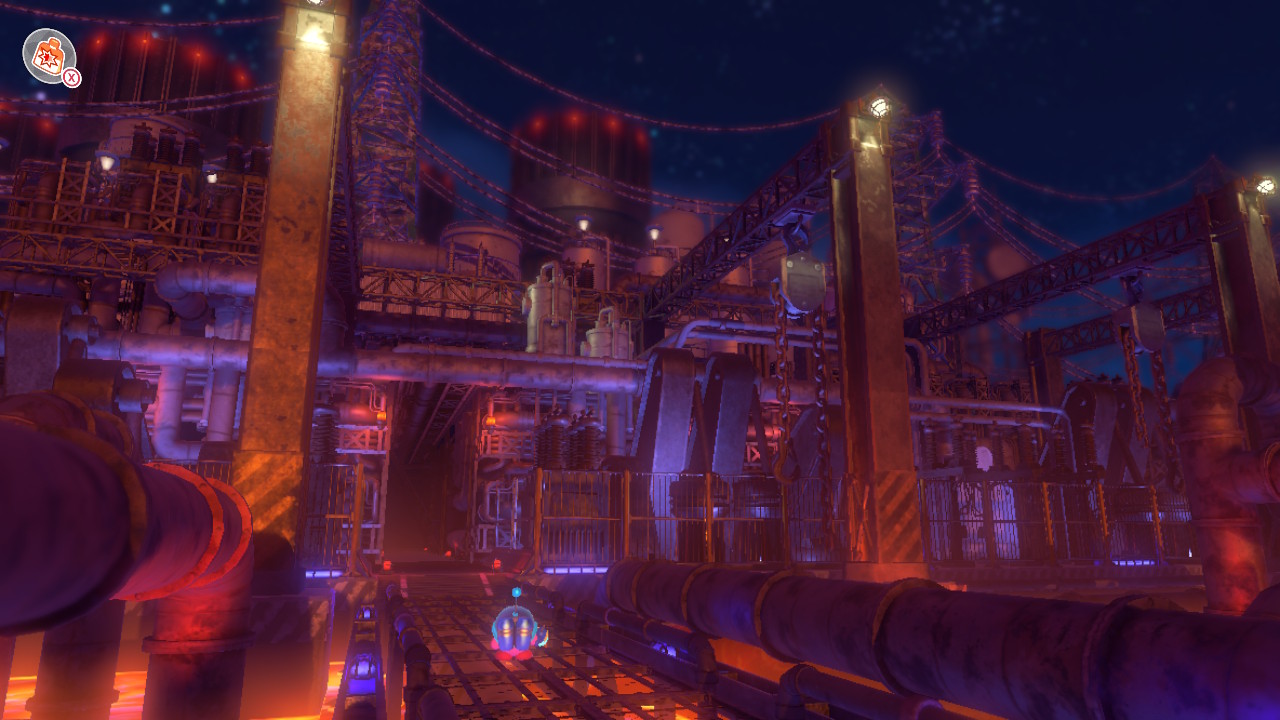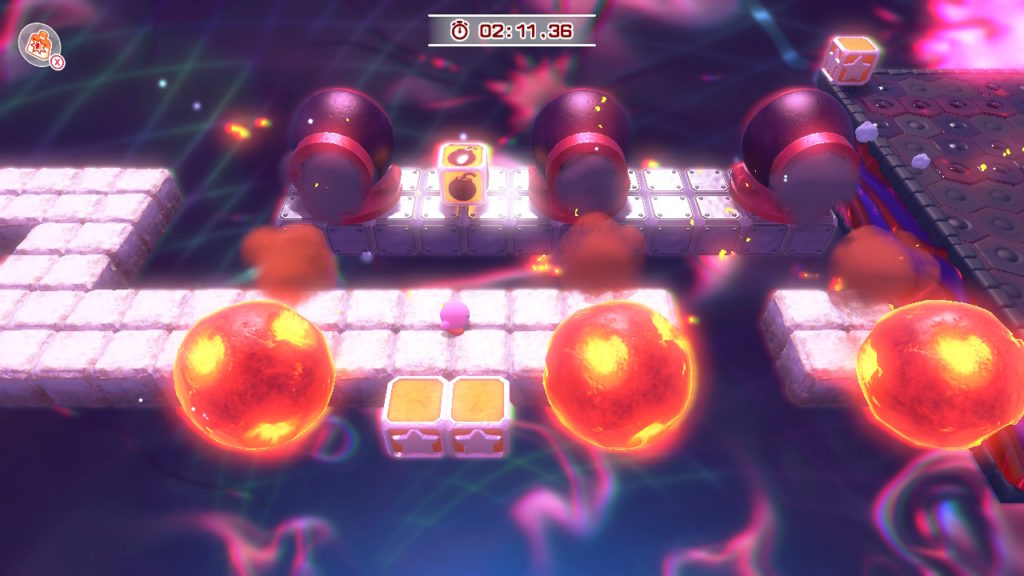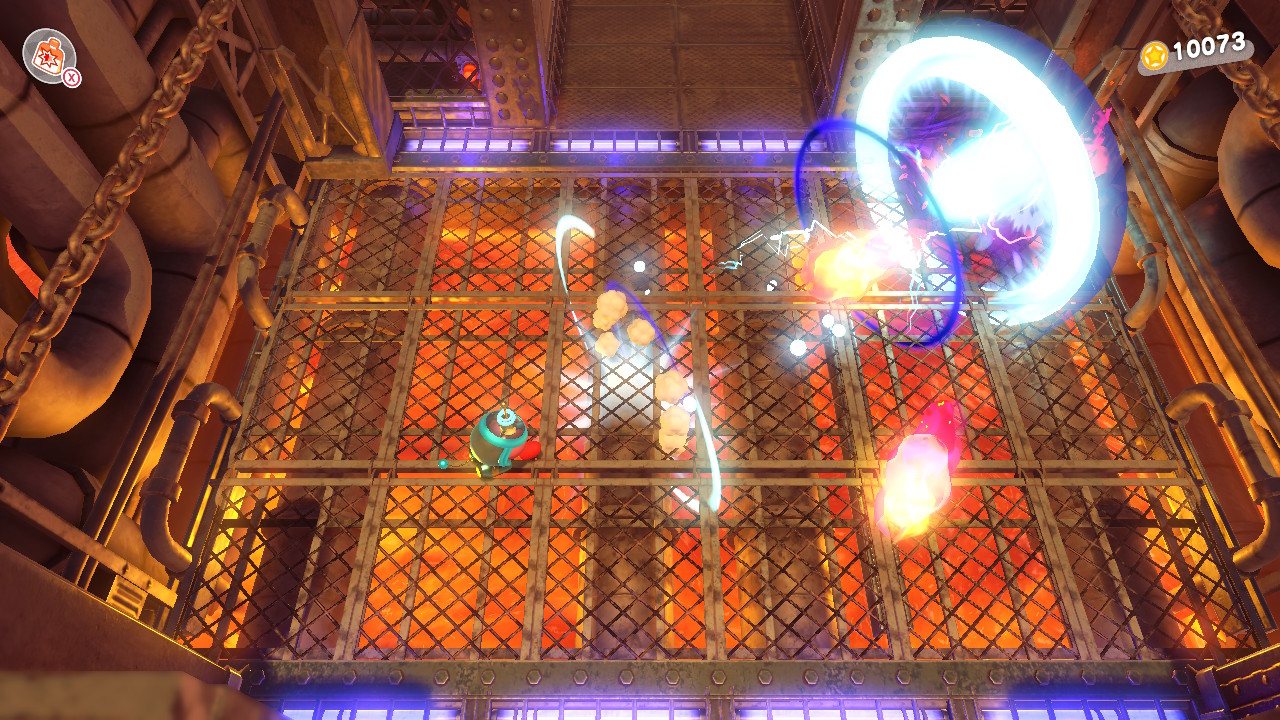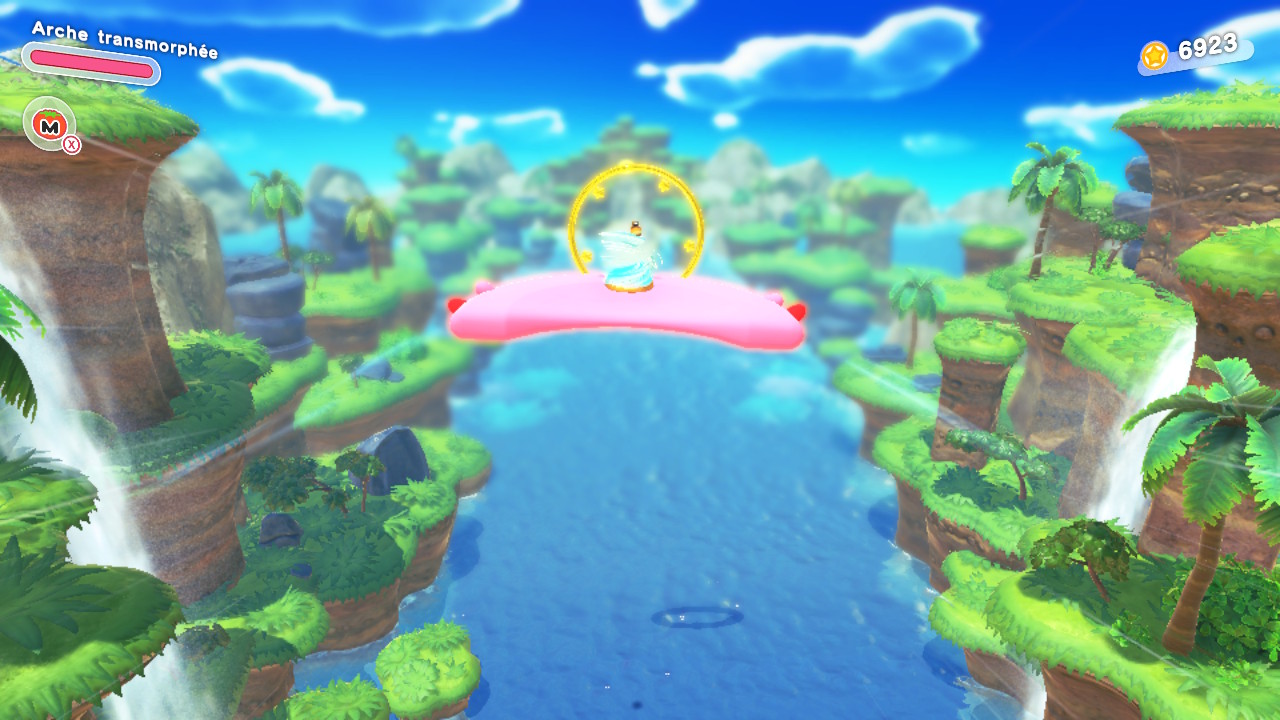Alors que le retour de The Twilight Zone orchestré par Jordan Peele s’était montré plutôt décevant et que les deux saisons d’American Horror Stories sombraient dans des abysses de médiocrité, Guillermo del Toro annonçait de son côté sa propre anthologie horrifique à destination de Netflix. Une aubaine pour les amateurs de frissons quand on connaît la passion de l’homme pour le genre et toutes les créatures qui s’y tapissent. Si on retrouve dans cette Saison 01 plusieurs des univers de prédilection du maître (à commencer par Lovecraft), que valent les huit épisodes de ce Cabinet des Curiosités ?
Retrouver Guillermo del Toro à travers une anthologie n’est pas vraiment surprenant quand on connait son intérêt pour le genre et les avantages qu’offre ce format permettant de raconter des histoires distinctes en profitant d’univers différents. Bien que cette première saison respire la passion du maître pour Lovecraft (deux épisodes adaptent directement une nouvelle et plusieurs autres s’en inspirent grandement dans leurs ambiances et/ou thématiques), del Toro s’est entouré de réalisateurs(trices) de renom afin de légitimer son projet. Le résultat, si il n’est pas exempt de défauts, n’en reste pas moins très intéressant à suivre. Le revers de la médaille est que cette pluralité de cinéastes engendre forcément des disparités entre les épisodes qui sont loin d’être au même niveau. Ainsi, les trois premiers épisodes s’avèrent être les plus faibles. Lot 36 semble plutôt passer à côté de son sujet en expédiant sa fin tout en occultant certaines idées de son scénario alors que Rats du Cimetière se perd un peu entre ses influences en ne sachant jamais vraiment sur quel pied danser. Si L’Autopsie manque également de bases suffisamment solides et peine à convaincre malgré une chouette référence et un final on ne peut plus gore, c’est surtout La Prison des Apparences qui subjugue grâce à sa réalisation et son actrice principale parvenant à sublimer un thème somme toute classique (la recherche de la beauté à tout prix afin de briller en société) pour en proposer quelque chose de dérangeant et de marquant. Suivent les deux histoires les plus lovecraftiennes du lot qui représentent aussi parfaitement les qualités et défauts de cette S01. Alors que Le Modèle soigne aussi bien son esthétique que son acting ou bien encore son histoire en proposant une fin des plus glaçantes, le suivant (Cauchemars de Passage) se montre peu inventif dans sa construction et nous laisse sur notre faim malgré une belle créature et la présence de Rupert « Ron Weasley» Grint. Toutefois, l’anthologie se reprend en main dans sa dernière ligne droite avec deux excellents épisodes, l’un se reposant quasi entièrement sur la prestation de ses acteurs (L‘Exposition) alors que le deuxième (Murmuration) parvient à conjuguer habilement histoire de fantômes et histoire d’amour. Le résultat navigue constamment entre frissons et émotion et offre à cette saison 01 une bien belle conclusion. Vivement la suite !
- Episode 01 : Le Lot 36
- Durée : 45 minutes
Nick, un vétéran de guerre, rachète le contenu d’un container (le fameux Lot 36) afin de trouver la perle rare pour la revendre au plus offrant. Comme vous vous en doutez, ce qu’il va dénicher va aller au-delà de ses espérances, et cauchemars les plus fous. Le premier épisode de l’anthologie n’arrive pas à pleinement convaincre, la faute à diverses idées intéressantes jamais exploitées (la danse du précédent occupant avant de rentrer dans son box ne résultant sur rien de concret et demeurant inexpliquée), certains personnages laissés à l’abandon (Emilia) ou une fin bien trop expédiée pour véritablement marquer. La créature elle-même (pourtant imaginée par del Toro) s’avère plutôt classique pour un monstre « lovecraftien » et ne parvient pas à rehausser le niveau de ce premier segment réalisé par Guillermo Navarro (les séries Hannibal, Narcos).
- Episode 02 : Rats de Cimetière
- Durée : 37 minutes
Masson, gardien de cimetière, prend son travail très à cœur, au point de déterrer les cadavres les plus richement « décorés » afin de leur voler leurs objets de valeur. Il va très vite découvrir que des rats (dont il a une sainte horreur) procèdent de même en emportant les corps dans les profondeurs souterraines. Ne sachant jamais vraiment par quel bout aborder son histoire (l’horreur, l’humour, le monster movie), Rats de Cimetière a bien du mal à condenser son propos en l’espace de 40 minutes. Si certains passages sont réussis (le cauchemar de Masson), le dernier acte saute trop rapidement d’une ambiance à l’autre pour offrir à cet épisode une vraie personnalité, engoncée entre des références qu’elle digère moyennement, et auxquelles elle n’arrive jamais vraiment à la hauteur, ou un aspect anxiogène, accentué par la phobie de Masson mais atténuée par l’approche grand-guignolesque de la créature.
- Episode 03 : L’autopsie
- Durée : 57 minutes
Une nouvelle occasion loupée pour cet épisode se situant pourtant à la croisée (très intéressante) des chemins de films comme Hidden et l’Autopsie de Jane Doe. A l’image du précédent épisode, celui-ci semble constamment se chercher en optant pour une sorte d’entre-eux entre enquête, thriller et invasion extraterrestre. Malheureusement, le scénario peine à approfondir son histoire en ne mettant jamais vraiment en avant de véritables thématiques ou même la maladie du docteur Carl Winters incarné par F. Murray Abraham (Le Nom de la Rose, Last Action Hero, Mimic) pourtant à l’aise dans le rôle de ce légiste attendant que la mort l’emporte. La fin s’enferme alors d’elle-même dans une sorte de salmigondis gore, parfaitement orchestré mais déversant sa substance narrative en même temps que les intestins de ses personnages.
- Episode 04 : La Prison des Apparences
- Durée : 63 minutes
Sans doute l’un des épisodes les plus forts et marquants devant autant à sa réalisation jouant le jeu de focales déformées pour accentuer ce sentiment de malaise et surtout son actrice principale, sorte de canard boiteux désirant se transformer en cygne pour briller au sein de son groupe de collègues aussi superficielles qu’addict à une crème censée les rendre plus belles. A mesure que les minutes passent, la réalité de Stacey s’effondre et rien ne semble plus avoir d’importance si ce n’est ce produit miracle censé la rendre plus belle et par la même occasion plus populaire. Pouvant être vu comme un brulot envers le diktat de la « beauté à tout prix », voire du télé-achat, cet épisode évolue en même temps que son héroïne en transformant l’espoir d’un remède miracle en folie bien réelle de laquelle ne peut résulter rien de bon.
- Episode 05 : Le Modèle
- Durée : 62 minutes
Embrassant entièrement son thème lovecraftien, Le Modèle doit autant à sa période gothique, synonyme de décors et costumes réussis, qu’à son duo d’acteurs vedettes à commencer par l’excentrique et toujours excellent Crispin Glover (même dans un nanar comme Charlie et Ses Drôles de Dames). S’axant autour de peintures macabres provoquant la folie chez ceux les ayant admirés, l’épisode parvient à maintenir une sorte de malaise constant tant dans la relation qu’entretient l’étudiant William Thurber (le très convaincant Ben Barnes) et l’artiste Richard Pickman (Glover) surtout lorsque le second va refaire irruption dans la vie du premier et mettre en péril la famille qu’il a fondé des années après avoir coupé les ponts avec son «mentor». Esthétique et prenant, Le Modèle doit autant à ses acteurs, son production design qu’à sa fin, glaçante à souhait.
- Episode 06 : Cauchemars de passage
- Durée : 61 minutes
Si il est toujours agréable de retrouver Rupert Grint (excellent dans la série Servant), Cauchemars de passage s’avère malheureusement beaucoup trop classique pour surprendre. Si il réalise un sans faute d’un point de vue visuel (aussi bien dans ses décors, costumes ou sa créature principale), cette adaptation de La Maison de la Sorcière de H.P. Lovecraft se montre quelque peu redondante dans ses effets horrifiques ou même la façon de raconter la relation entre Walter Gilman (Grint) et Epperley, sa défunte sœur jumelle qu’il va tenter de ramener du monde des morts. En résulte un épisode semblant évoluer en pilotage automatique et dont ne résulte pas l’émotion, ou même l’effroi, qu’on aurait pu en attendre.
- Episode 07 : L’Exposition
- Durée : 56 minutes
Un épisode à deux vitesses qui se repose durant son premier acte sur l’ensemble de ses comédiens, à commencer par Peter Weller jouant le rôle de Lionel, l’un de plus riches hommes de la planète qui invite quatre experts dans leurs domaines respectifs afin de l’aider à percer un mystère qui le taraude depuis des années. Jouant avec la curiosité des spectateurs désirant ardemment connaître la raison pour laquelle les invités ont été conviés, L’Exposition fait monter la pression à travers sa réalisation très posée à laquelle la musique et le grain de l’image ajoutent une touche étrange héritée des eighties. La seconde partie de l’épisode nous confronte au pourquoi du comment (que je vous laisse découvrir par vous-mêmes) et ce, à travers de réjouissants débordements gores ou une fin des plus nihilistes. Délectable.
- Episode 08 : Murmuration
- Durée : 63 minutes
Cette première saison de l’anthologie de del Toro se termine de la plus belle des façons via un épisode réalisé par la talentueuse Jennifer Kent (Mister Babadook, The Nightingale). Il met en scène deux ornithologues, Nancy et Edgar Bradley, parfaitement interprétés par Essie Davis (Mister Babadook) et Andrew Lincoln (The Walking Dead, Love Actually), qui s’isolent sur une île afin d’étudier les dindons de Virginie. La force de l’épisode réside dans la faculté de Kent à mélanger l’histoire personnelle de ses personnages, dont l’amour a dû faire face à une terrible perte, et celle des anciens habitants de la maison dans laquelle ils résident. A l’image de ce qu’elle avait déjà fait dans Mister Babadook, la réalisatrice australienne réussit aussi bien sur le tableau de l’émotion, grâce à ses deux acteurs, que sur celui de l’horreur à travers des cadrages maîtrisés et une utilisation parfaite des zones d’ombre pour susciter l’effroi.





Bien que certains segments déçoivent à cause d’un manque d’homogénéité ou d’un scénario trop faible, cette première saison du Cabinet des Curiosités s’en sort avec les honneurs et se montre surtout bien au dessus des deux saisons de la catastrophique anthologie American Horror Stories. Si on notera quelques épisodes maladroits, on pourra tout de même louer les efforts concernant la réalisation, les décors et les effets de maquillage. On retiendra surtout quatre fabuleux épisodes qui nous font espérer une Saison 02 aussi riche et variée avec, pourquoi pas, le maître de cérémonie lui-même derrière la caméra.