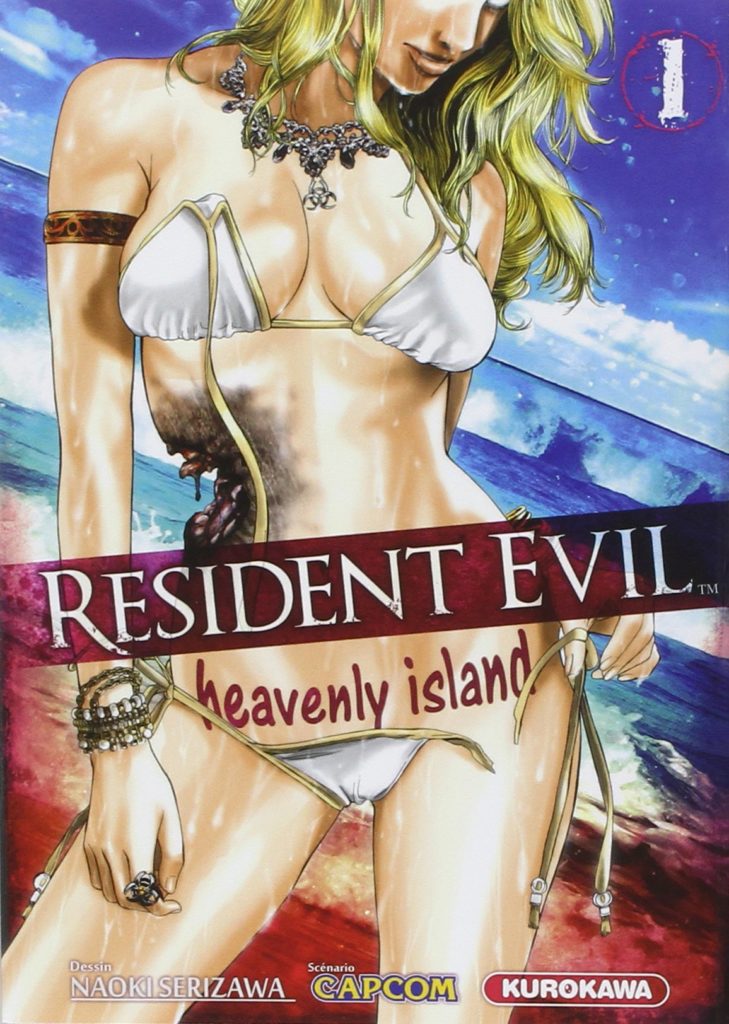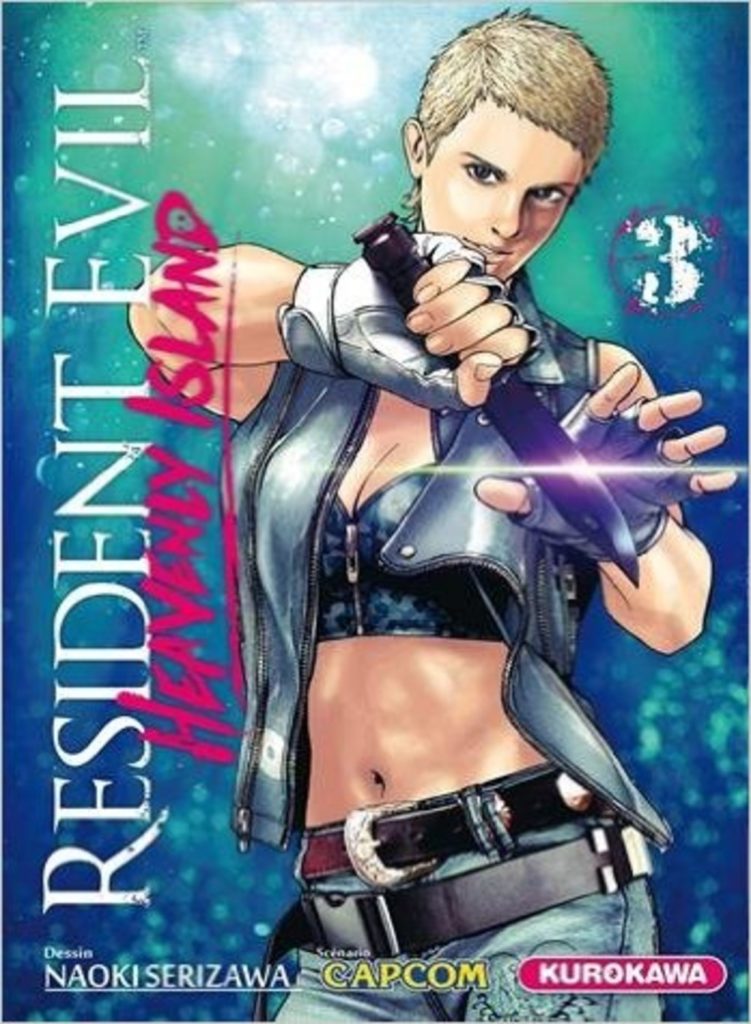Alors que les premières images de l’adaptation cinématographique du roman d’Ernest Cline, Player One, sont apparues il y a peu sur la toile, retour sur ce livre offrant une vision fantasmée de ce que pourrait donner la Réalité virtuelle d’ici plusieurs années.
Si en 2011, date à laquelle sort le roman Player One, l’histoire de Wade, errant dans un gigantesque monde virtuel, pouvait paraître quelque peu surréaliste, elle devient en 2017 un peu plus crédible, ne serait-ce que grâce aux progrès en matière de VR. Bien sûr, nous sommes encore loin, très loin même, de pouvoir vivre des aventures aussi palpitantes que celles que vont connaître les protagonistes du roman mais malgré cet état de faits, le livre de Cline hypnotise, ne serait-ce qu’à travers les images très précises naissant dans l’esprit du lecteur, surtout si ce dernier est né dans les années 80. Nous sommes en 2044, la Terre meurt peu à peu et les différences sociales sont de plus en plus marquées. Pour éviter de sombrer dans un quotidien ne leur apportant plus rien, la majeure partie de l’humanité se réfugie dans l’OASIS, un univers virtuel intégrant des milliers de mondes (contemporains, SF, Fantasy) où, moyennant finances, tous les rêves semblent possibles. Imaginez une fusion entre World of Warcraft et Second Life, autrement dit un gigantesque sandbox qui n’aurait de limite que votre imagination et vos crédits. Vous avez toujours rêvé d’être un chevalier Jedi pilotant l’un des robots d‘Evangelion tout en maîtrisant les arcanes de la magie ? Il ne vous reste qu’à créer un compte et à vous lancer dans l’aventure. Toutefois, lorsque James Halliday, le créateur de l’OASIS meurt sans héritiers, il organise une gigantesque chasse au trésor posthume avec comme récompense sa fortune personnelle estimée à 250 milliards de dollars. Une somme rondelette pour qui trouvera les trois clefs cachées dans l’OASIS. Mais avant d’y arriver, les participants devront faire face à de nombreuses énigmes et dangers disséminés tout au long du chemin que suit Wade (aka Parzival), 17 ans, le protagoniste principal de ce roman, véritable cri d’amour aux eighties, à la culture pop et aux jeux vidéo. En effet, durant plus de 600 pages, Ernest Cline s’amuse à saupoudrer son livre de références à cette période via des clins d’oeil à tout un pan de la culture geek en citant à tour de bras, films, séries, livres et bien entendu jeux vidéo. D’ailleurs, outre des références à des œuvres vidéoludiques et cinématographiques cultes (Galaga, Pac-Man, Retour vers le Futur, Blade Runner…), le premier renvoi à cette période est sans conteste le personnage de James Hallyday, sorte de mixe entre Richard Garriot, Bill Gates et Steve Jobs.
Si on pouvait craindre que Player One ne soit au final qu’une accumulation hasardeuse de références à la pop culture, Cline se montre un peu plus malin en intégrant celles-ci dans la progression du récit via des épreuves demandant à Wade de maîtriser tel ou tel jeu sur le bout des doigts, de connaître à la perfection telle série animée, etc. Il est amusant de noter que certaines idées feraient fureur aujourd’hui si la Réalité Virtuelle avait atteint le stade décrit dans le livre. On pensera notamment à celle demandant aux héros de revivre littéralement un film à la place d’un acteur avec l’obligation de connaître chaque dialogue et chaque geste du personnage sous peine de Game Over. A mesure que le roman évolue, on suit l’intrigue plutôt convenue qui, de chasse au trésor (idéale pour passer de monde en monde et offrir au roman ce côté aventureux), va progressivement se transformer en chasse à l’homme jusqu’à se conclure en immense morceau de bravoure à l’intérieur de l’OASIS. On regrettera à ce titre une conclusion démesurée donnant l’impression de se faire au détriment des relations entre les membres du sympathique trio que forment Wade, Art3mis et Aech, qu’on aurait aimé un peu plus développées. Malheureusement, sur ce point, c’est une déception car sorti d’un amour d’adolescents et de l’amitié entre Wade et Aech, Cline ne prend jamais vraiment le temps de creuser ses personnages, que ce soient les héros (Daito et Shoto, deux japonais rejoignant le trio, n’échappent pas à ce constat) ou les Sixers, archétype de la multinationale simplement vouée à conquérir le monde réel et virtuel. De même, il est un peu frustrant que l’auteur ne s’attarde jamais vraiment sur le monde extérieur autrement qu’en de rares exceptions afin de décrire l’appartement de Wade ou les locaux des Sixers. On aurait apprécié d’en savoir un peu plus sur cette sorte de dystopie. Pour autant, grâce au style (assez lambda, avouons-le) du romancier, la lecture de Player One s’avère agréable même si les fans ardus de science-fiction le trouveront sans doute trop quelconque, le récit très commun (malgré un socle narratif solide) privilégiant les références à une véritable forme d’anticipation. On attendra malgré tout de voir ce que donnera l’adaptation cinématographique réalisée par Steven Spielberg, prévue pour mars 2018, qui devra faire le choix d’assumer l’amour de Cline pour les Années 80 ou d’actualiser son propos en intégrant des références plus actuelles. Le premier trailer affichant des icônes telles Le Géant de Fer, Freddy Krueger, la DeLorean ou bien encore Duke Nukem, on a de quoi être rassurés.